Extrait : Les valises
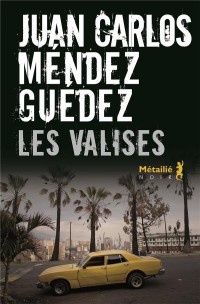
Les deux corps étaient devant l’immeuble, serrés l’un contre l’autre, comme endormis à l’intérieur d’une voiture de couleur bleue : lèvres pâles entrouvertes, mâchoires rigides. À cet instant, Donizetti imagina que les figures de cire devaient ressembler à ça. “Mais cette odeur”, se dit-il mal à l’aise tout en se grattant le bout du nez qui avait détecté un relent d’eau croupie.
Il appela Verónica sur son portable : “Quand tu descendras avec Amanda pour l’amener à l’école, ne sors pas par la porte de la rue, passe par la sortie du parking. Ils ont tué une femme et son gosse.”
Il regarda sa montre. Un geste machinal. Quelques secondes plus tard, il avait oublié s’il était tôt, s’il était tard, s’il lui restait du temps pour aller au travail, prendre l’enveloppe avec l’argent pour le voyage, récupérer la valise au moment exact.
Il fit quelques mètres. Tendit le cou pour regarder. Donizetti ne comprit jamais pourquoi il s’était arrêté devant les corps. Il était sûr qu’aucun de ses confrères de l’agence ne couvrirait l’info. Ils avaient pour instruction de ne pas rendre compte de trop de meurtres et la veille au soir, alors qu’il était de garde, il avait dû faire une dépêche sur un triple homicide à La Vega. Cinq paragraphes rédigés à la va-vite qu’il n’avait finalement pas mis en ligne parce qu’un autobus s’était renversé près de San Cristóbal et c’était déjà assez de sang pour un dimanche.
La brume du matin semblait irréelle, comme si tout se déroulait ailleurs, dans un endroit lointain. Mais au même moment surgit un photographe d’une agence internationale Leonard et Hagler (un combat spectaculaire, une merveille où Sugar a terminé en apesanteur sur le ring, balançant des rafales de coups de poing sur le petit chauve), on avait entendu trente ou quarante coups de feu. Je m’étais jeté par terre avec la télécommande. Ça avait duré cinq minutes.
C’était bizarre. À cette époque, c’était vers minuit que ça commençait à tirer. Un événement important avait dû se produire pour que les échanges de coups de feu débutent plus tôt. Un moment plus tard, mes parents avaient parlé au téléphone avec les voisins du onzième étage ; ils leur avaient dit que les dealers de l’autre côté de l’avenue avaient essayé de conquérir un nouveau territoire et que le caïd de ce côté-ci avait dû s’efforcer de les repousser.
C’est comme ça que j’ai connu le pouvoir et la destinée de Pancho. Le voisin normal qui m’avait dit un jour travailler dans un supermarché était le caïd des trafics sur cette partie de l’avenue.
À partir de là je me suis dit que Pancho était une option, la sortie de secours de ma propre existence, comme si une part de son pouvoir m’avait appartenu rien que parce qu’on avait grandi ensemble.
Mais cet horrible après-midi où le portable ne sonnait pas ; cet après-midi de montres molles, d’air huileux ; cet après-midi j’ai compris que je devais retourner au boulot et que le portable ne sonnerait pas parce qu’il avait trop sonné, et que cette fois Pancho ne viendrait pas me sauver ; cette fois, même dormir sur le sol de la salle de bains n’allait pas me calmer.
Je me suis levé. Je suis allé dans la chambre de tante Felipa pour éteindre les bougies sur l’autel de María Lionza.
Brusquement j’ai senti un bourdonnement sec, le bruit d’un ballon qui se dégonfle. Merde. Encore une coupure de courant. J’allais devoir descendre les vingt étages par l’escalier.
J’ai senti le soleil comme un coup de rasoir sur le visage.
Le portable ne sonnait toujours pas.