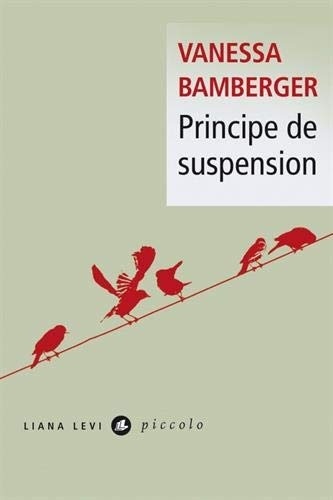Principe de suspension
«10% de talent, 90 % d’efforts.» C’est la devise de Thomas pour défendre son usine et ses salariés. Depuis qu’il a racheté Packinter, une PME de la filière plastique, il lutte pour conjurer le déclin de l’industrie dans sa région du Grand Ouest. Un hiver pourtant tout bascule, et il se retrouve dans la chambre blanche d’un service de réanimation, relié à un respirateur. À ses côtés, Olivia, sa femme, attend son réveil. Calme, raisonnable, discrète. Comme toujours. Dans ce temps suspendu, elle revit les craintes des ouvriers, les doutes de Thomas, les trahisons intimes ou professionnelles qui les ont conduits jusqu’à ce grand silence, ce moment où se sont grippés le mécanisme des machines et la mécanique des sentiments. Parce que la vie s’accommode mal de l’immobilisme, il faut parfois la secouer un peu, selon le «principe de suspension».
Un premier roman juste et subtil sur le blues du petit patron et le fragile équilibre du couple.
Vanessa BamBerger vit à Paris. Principe de suspension, son premier roman, témoigne de son admiration pour tous les acteurs de l’industrie française auxquels l’époque n’épargne rien.
Extrait
4 mars
Dans la chambre de réanimation du Centre hospitalier de Cambregy, l’air est rare et poisseux. Le soleil de printemps, anormalement fort, s’infiltre en fines rayures à travers les stores baissés. Il dépose ses particules de lumière cuivrée sur les murs, où les couches successives de peinture blanche rappellent à Olivia que cette même chambre, cet espace clos et carré a scellé la fin d’autres vies.
Thomas est étendu sur le lit médicalisé, son long corps est couvert d’un drap jusqu’aux aisselles, le blond clair de ses cheveux se fond sur la taie d’oreiller, ses orteils et son crâne touchent les extrémités du lit comme si on l’y avait fait entrer de force. Sa peau a pris une teinte crayeuse, ses paupières semblent faites de mousseline, ses lèvres sont déformées par le sparadrap et le long tube flexible qui en jaillit, relié au respirateur dont Olivia entend le bruit de lave-vaisselle. La poitrine de son mari se soulève et retombe mécaniquement au rythme du soufflet de la machine, et Olivia scrute avec inquiétude ses côtes saillantes que le drap souligne au lieu de dissimuler.
S’il était éveillé, ne peut-elle s’empêcher de penser, Thomas serait certainement fasciné par cette machine, il en admirerait l’ergonomie, la précision des données sur les écrans de contrôle, il s’intéresserait au fonctionnement du cube bleu et blanc, voudrait comprendre, étudier le mécanisme qui détecte le moindre effort respiratoire du malade, connaître la logique de son algorithme, et les différents types de modèles de ventilateurs, les marques, l’évolution des techniques. Il aurait confiance, ne craindrait pas la panne, ne jugerait pas, au contraire d’Olivia qui la fixe douloureusement depuis quatre jours, cette machine écœurante. Il n’aurait pas peur, lui, que sa poitrine arrête de se soulever.
Elle se penche, approche son visage, colle ses narines contre la joue de Thomas. L’épiderme est mou. Hier, la peau était déjà un peu ternie mais plus ferme, elle en est sûre, c’est même sa particularité, aucun relâchement, aucune ridule ne trahit ses quarante ans. Et voilà qu’il se distend, qu’il se délite sous ses yeux... Il est en train de mourir. Elle tend la main vers le bouton d’appel, mais renonce, embarrassée. Le médecin vient juste de sortir. Elle n’ose pas le rappeler. C’est normal que sa peau soit moite et molle, il fait si chaud, se dit-elle pour finir.
Roux et baraqué, les yeux saillants et mobiles, le docteur Frédéric Miat donne l’impression d’être tout juste descendu d’un vélo de course et pressé d’y remonter. Il marche et parle vite, ne s’attarde pas au chevet de son patient. Olivia n’a pas le temps de poser toutes les questions qui l’assaillent. Tout à l’heure, elle était en train de lui demander si cela arrivait souvent, un coma après une détresse respiratoire, mais il ne lui a pas laissé le temps de finir sa phrase, il l’a coupée après «coma» avec un petit soufflement agacé. Les constantes sont bonnes, a-t-il dit. Il a vaguement souri et détourné la tête, alors elle n’a pas insisté. C’est ridicule, ce manque d’assurance qui la poursuit jusque dans cette chambre d’hôpital. Elle devrait avoir plus de courage, quelque chose comme du souffle pour deux.
Olivia tressaille de honte en repensant au jour de l’accident. Ce matin-là, elle était rentrée de vacances mais il était si tôt qu’elle s’était recouchée. Elle est si fatiguée en ce moment, malgré le séjour à la montagne, toujours un goût de glaise en bouche, des fourmillements dans les mains, les muscles des paupières qui tressautent, les reins douloureux. Elle avait croisé Thomas dans le jardin, il partait pour l’usine. Elle avait remarqué sa toux, sa mauvaise mine, mais l’avait laissé monter dans sa voiture. Quand elle s’était réveillée, il était dix heures passées. Elle s’était étirée longuement, elle avait roulé sur le lit les bras écartés, restant de longues minutes à contempler le plafond. Des flammèches dorées s’élevaient dans la poussière, jouant à se chasser l’une l’autre, et elle avait repensé à son unique voyage de jeunesse. Une traversée des Alpes, seule, un été. Quand le train longeait un lac, elle faisait la course avec les poissons volants de lumière que le soleil projetait sur l’eau. De la chambre de ses fils ne provenait aucun bruit. S’étaient-ils rendormis, eux aussi? Peu probable. Que trafiquaient-ils donc? En temps normal, Olivia aurait bondi de son lit, mue par l’inquiétude, la presque certitude de la catastrophe. L’enfant étranglé par la corde des rideaux, ou enfermé dans le coffre à jouets, rejoint par son frère et tous les deux prisonniers de l’osier, étouffés, les possibilités étaient infinies. Mais là, elle n’éprouvait rien de tel. C’était si bon d’être seule dans le silence, c’était cela qui lui manquait, la possibilité de la solitude, un long ruban de temps qu’aucune obligation ne viendrait couper et qui lui rendrait l’élan perdu.
Ses fils l’envahissaient, ralentissaient son travail. Mais c’est Thomas qui l’affaiblissait. L’ambiance délétère qu’il instaurait à la maison. Ses accès de colère. Sa maniaquerie. Son insensibilité. Son agitation. Un champ magnétique semblait le parcourir, l’isolant des membres de sa famille tout en aspirant leur énergie, perturbant leur système. Il n’en parlait pas mais elle se doutait qu’il avait de sérieux problèmes à l’usine. Pour autant, rien ne justifiait un tel comportement.
À dix heures passées, Olivia venait de décider de s’accorder un répit, et pendant ces instants où elle accusait son mari, se délestant agréablement du poids de son propre échec professionnel, elle avait éprouvé un tel soulagement qu’elle avait failli oublier ses enfants.
Maintenant, Thomas gît devant elle, son immense corps relié à une machine, son beau visage désaccordé.
Comment être sûre qu’il ne souffre pas, voilà la question qu’elle aurait dû poser au docteur Miat. Les constantes sont bonnes, mais il ne respire pas seul, c’est comme s’il dormait, mais comment être sûre qu’il ne souffre pas ?
Face au médecin, elle est restée droite, son long cou droit lui aussi, les mains tranquillement posées sur ses genoux. Olivia se tient, c’est une habitude, elle ne donne jamais une impression de faiblesse. Miat n’a pas vu son angoisse. Personne ne la voit. Pas même Thomas, pas même son père. Elle est si calme, lui disent-ils. Parfois cela sonne comme un reproche. Ils ne savent pas à quel point la plus infime variation dans son environnement physique, le moindre sursaut d’émotion la font vaciller, et son apparente tranquillité, tel le vernis qu’elle applique sur ses peintures, un film incolore et solide, lui offre la seule défense possible. Cela ne servirait à rien de montrer qu’elle a peur.