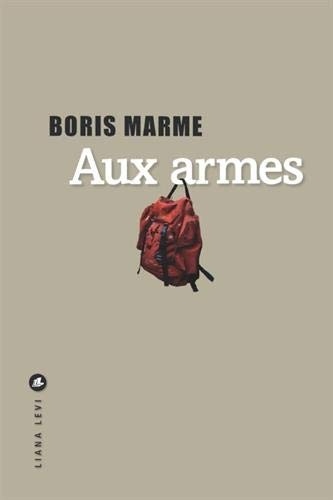Aux armes
Un beau matin à la fin de l’hiver, dans les couloirs d’un établissement scolaire américain, des bruits semblables à des tirs d’arme à feu résonnent subitement. Alerté, l’officier responsable de la surveillance, Wayne Chambers, accourt sur les lieux, mais demeure figé à proximité du bâtiment, derrière la porte où semblent se produire les déflagrations. Tétanisé, il hésite à en franchir le seuil. Doutes sur la provenance des balles? sur la conduite à tenir? peur? Quand la fusillade prend fin, il n’est pas entré dans les classes où sont étendus les corps de quatorze jeunes élèves, mais déjà réseaux sociaux et chaînes d’info s’emballent: la machine médiatique affûte ses armes. Une machine au service des voyeurs de l’actualité, des donneurs de leçon et des aspirants justiciers qui entendent s’ériger en tribunal populaire et faire un sort à cet homme que rien ne pouvait préparer à devenir un héros.
Boris Marme enseigne les lettres modernes dans un lycée de la région parisienne. Dans ce premier roman, il dresse un tableau de la société implacable vers laquelle nous cheminons.
Extrait
Wayne pousse la lourde porte vitrée du Marlon Park Cafe. L’endroit n’est pas plein comme toujours à cette heure-là, il est encore tôt, les gens prennent à emporter et filent au boulot. Wayne s’avance vers le comptoir. Il salue avec amabilité les deux clients échoués chacun à une table et qui mangent leur bagel en dialoguant silencieusement avec leur téléphone portable.
« Salut Dorothy, comment ça va ?
– Hello, darlin’, qu’est-ce que je te sers ce matin ? » Dorothy sait très bien ce qu’il va lui commander. Comme à chaque fois, le même grand café et le même bagel. Il pourrait tout juste lui lancer «Comme d’habitude!», mais elle et lui ne veulent pas se priver de ces quelques phrases banales.
Wayne aime entendre ce «darlin’», même si Dorothy appelle tous ses clients «darlin’», avec cette assurance de diva de comptoir qui fait le spectacle. Lui y croit. Ce petit mot doux rien que pour lui. Wayne chéri. Il vient le chercher presque chaque matin et puis s’en va avec son bagel et son café préparés par sa petite femme, comme s’ils étaient mariés quelques minutes par jour seulement entre les murs du Marlon Park Cafe. Un peu d’attention et d’affection avant de commencer la journée, au contact de cette femme à la jeunesse fatiguée, pas vraiment jolie dans son tablier rouge, mais terriblement charmante avec sa voix de velours griffé.
«Un grand café et un bagel sésame avec des œufs et du bacon, s’il te plaît!» Wayne se dit parfois qu’il aimerait bien goûter à autre chose, prendre le bagel aux oignons ou, pourquoi pas, les saucisses et le cheddar, mais il n’ose pas, comme si ce rapport privilégié entre elle et lui allait être rompu, qu’elle ne l’appellerait plus «darlin’» s’il changeait sa commande.
Au fond, peu lui importe ce qu’il mange. Ce qu’il aime, c’est la regarder s’occuper de lui, répéter les mêmes gestes précis, efficaces et rapides : frotter énergiquement la planche de cuisson, y déposer les deux tranches de bacon applewood, trancher le bagel sésame, en déposer les deux moitiés sur la grille du toaster, casser les œufs, les fouetter en quelques coups de fourchette, les verser à côté du bacon, retourner le bacon déjà racorni, rassembler les bords de l’omelette avec sa spatule, la retourner.
Il la regarde faire, en silence, il n’a souvent pas grand-chose de plus à lui dire. Il rebondit parfois sur le temps qu’il fait, partage avec elle une réaction laconique à un événement national ou local. Il ne sait rien d’elle, de sa vie cachée derrière le tablier rouge du Marlon Park Cafe. Il n’a jamais posé la moindre question à sa petite femme. Elle non plus ne sait rien de lui, elle lui répond quand il parle, se tait quand il ne dit rien.
Dorothy s’empare des tranches toastées, y dépose l’omelette brunie et le bacon, fourre le tout dans une fine enveloppe de papier paraffiné entouré d’une serviette en papier, sert le café dans un large gobelet en carton, le referme d’un couvercle en plastique, puis lui tend le tout sur le comptoir.
« Voilà pour toi, darlin’, attention le café est brûlant ! 7,50 $ s’il te plaît. »
Wayne la paye puis soulève légèrement l’enveloppe de papier et la tranche supérieure du bagel, se saisit de la bouteille de ketchup, la renverse et la secoue en pressant son gros corps de plastique mou. Le ketchup est alors expulsé dans un bruit de grossière détonation et vient exploser sur la chair du bagel, projetant de petits éclats rouges sur le manteau, la chemise et la cravate de Wayne.
«Dammit!»
Dorothy lui tend des serviettes en papier avec un sourire amusé : « Tu commences bien ta journée ! »
Wayne frotte rapidement ses vêtements sombres, ça n’est pas si grave, ça se voit à peine.
« Merci Dorothy. Bonne journée.
– Bonne journée à toi aussi, darlin’. Tâche de ne pas faire d’autres bêtises aujourd’hui.
– J’espère pas ! » répond Wayne en riant de bon cœur. La lourde porte vitrée se referme derrière lui.
La tête engoncée dans le col en fourrure de son manteau, il regagne sa Ford blanche au pas de course. L’hiver est revenu à la charge, hier, par surprise, balayant d’un coup le printemps qui montrait le bout du nez. Un peu de neige est même tombé. Ça n’a pas tenu bien longtemps sur les routes, heureusement. À peine dans les jardins et sur les toits. La pagaille évitée. Mais du coup le thermomètre s’est cassé la gueule cette nuit, et ce matin, malgré le ciel bleu, le froid vient mordre de ses petites dents aiguës le bout des oreilles et des doigts.
Wayne monte dans la voiture en s’ébrouant. Il pose le café dans le porte-gobelet, mais garde le bagel en main, ce froid lui donne envie de croquer dedans. Rien qu’une bouchée, il mangera le reste là-bas. Wayne plonge les dents dans un morceau bien juteux, ramène maladroitement la tête et le corps en avant pour éviter de s’en mettre partout. Hmmm ! Dorothy est la meilleure. Il pourrait dévorer le truc maintenant, mais il doit y aller.
Au moment de mettre le contact, son téléphone sonne. Un message de sa mère. «N’oublie pas de passer chez CVS pour mes pilules. » Il répond tout de suite avec la prévenance d’un bon fils, pour ne pas qu’elle s’inquiète, ça lui donne des douleurs.
Wayne s’engage sur Fulton National Pike puis sur St Marks Lane. À la radio, on joue And It Stoned Me de Van Morrison, une chanson qu’il n’a pas entendue depuis un bail, mais qui lui revient avec une familiarité heureuse, le met de bonne humeur, lui donne envie de chanter. Au moment du refrain, il monte le volume et se met à entonner d’une voix maladroite: «Oh, the water/ Oh, the water.../ Oh, the water/ Hope it don’t rain all day.» Mais en tournant à droite sur Patterson Road, il se ravise, il ne peut pas se le permettre. Il préfère éteindre la radio et remonter en silence le demi-mile jusqu’au croisement avec Haskins Road.
Là, face à lui, s’étalent les larges formes rectangulaires du lycée Barbara J. Haskins.
Le grand parking devant l’établissement est encore désert, à peine quelques voitures de professeurs ou de membres du staff. Wayne se gare à sa place habituelle, non loin de l’allée qui mène à l’entrée principale, le meilleur point de vue pour ne rien rater des allées et venues des élèves et pour garder un œil sur la rue. Il coupe le moteur. Il est à son poste. D’ici un petit quart d’heure, tout autour de lui sera comme un immense verre qui se remplit en quelques minutes d’un flot d’eau pétillante. Son travail commencera alors. Pour le moment, il a mieux à faire. Il saisit le bagel et le dévore en quelques bouchées comme un gamin gourmand qui a besoin de gaver au plus vite son plaisir. Ce genre de belle affaire ne traîne jamais avec lui. Remplir le trou de l’estomac, au point d’affamer le cerveau. L’impression de n’avoir rien mangé, la frustration de ne pas en avoir un autre sous la main, juste la moitié d’un autre, une bouchée.
Son téléphone se met à tinter de nouveau. Encore un message de sa mère. «T’as l’ordonnance? N’oublie surtout pas mes pilules. Nuit de merde ! Mal au dos. » Wayne répond sans broncher. Il passera chez CVS, qu’elle ne s’inquiète pas.
Nouveau message de sa mère qui lui reproche de ne pas être plus compatissant. Elle a mal !
Et merde, un faux pas! Elle ne va plus le lâcher. Pas le temps de répondre. Un nouveau message tombe et un autre, puis un autre. À chaque fois, le même son de cloche accusatoire. Mauvais fils. Il la laisse toute seule. Elle pourrait crever qu’il s’en fout ! Il ne sait pas ce qu’elle endure.
Wayne s’empresse maintenant d’éteindre l’incendie. Il balance nerveusement tout ce qu’il peut de mots rassurants et aimants, tout ce qu’elle peut gober, il n’y a pas d’autre manière de faire. Elle est bien capable de lui envoyer une quarantaine de messages. Ce besoin de l’accabler, de planter ses reproches blessants pour se soulager. Après, elle ne s’en souviendra plus. Elle se montrera douce comme si rien ne s’était passé.
Le téléphone ne tinte plus. Le feu a été vite éteint. Mais Wayne reste sur ses gardes quelques longs instants.
Plus rien. Elle est déjà passée à autre chose. Sans doute un truc à la télé qui a détourné son attention.
Le froid est peu à peu entré dans la voiture et s’est répandu dans l’habitacle comme un gaz inoffensif, apportant avec lui le silence du dehors. Wayne aime ces rares instants, lorsque toutes les voix et tous les bruits humains s’effacent, que le monde autour de lui devient muet. Il a quelquefois la chance de le goûter, ce silence, à la chasse, au milieu d’un champ ou dans le corset d’un sous-bois, un peu en retrait de Mike et de Doug, au moment où les fusils se taisent et que les derniers échos en feu s’estompent au loin. Pendant quelques instants, cette impression d’être seul au milieu d’un autre monde, de s’abandonner à lui-même, délesté de tout ce qui l’habite quotidiennement, subitement enveloppé par les bras délicieux du silence qui s’exprime enfin sans être refoulé, un silence sonore qui résonne des battements de son corps et des murmures de la nature.
Le visage immobile, le regard perdu dans le silence du parking, il attend. Ses pensées s’accrochent à peine, il les laisse filer, informes, inutiles. De temps en temps, mécaniquement, il saisit son café, le sirote, le repose, le reprend.