Extrait : Nettoyeuse : Comment tenir le coup dans un sale boulot
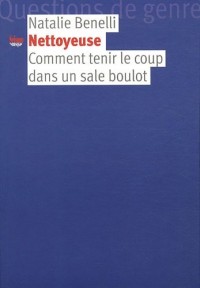
Introduction
La propreté est une valeur absolue et incontestée des sociétés riches. Les normes qui la régissent sont à la fois multiples et précises et concernent tous les domaines de la vie sociale. La propreté des espaces intérieurs et extérieurs est associée à plusieurs choses : l'esthétique et la beauté, la santé et l'hygiène, l'ordre et la sécurité, la décence et la respectabilité, l'efficience et la productivité. Ces dimensions traversent les espaces et les lieux privés et publics, les activités économiques aussi bien que le quotidien non-marchand. Ainsi, quartier propre rime avec quartier décent, usine propre avec productivité et efficacité. En revanche, ce qui est sale est suspect, voire immoral. Le sale, c'est ce qui n'est pas à sa place, ce qui brouille les frontières entre le bien et le mal et menace l'ordre social (Douglas, 1971). Éliminer la saleté, c'est (re) mettre de l'ordre. Par exemple, avec chaque tournée de ramassage et d'enlèvement des déchets, les éboueurs reconstruisent la frontière entre le désirable et le repoussant, entre ce qui a droit d'être dans l'ordre social et ce qui ne l'a pas (Bauman, 2006).
Toutefois, alors que l'élimination de la saleté est une fonction sociale fondamentale, le nettoyage est considéré et traité comme une activité annexe, marginale. L'entretien du ménage, comme le travail domestique en général, effectué gratuitement, par les femmes en majorité, n'est pas considéré comme un vrai travail. Perçu comme non productif, il n'est pas pris en compte dans le calcul du PIB d'une nation. Dans la sphère marchande, l'exercice du nettoyage est économiquement et organisationnellement subordonné aux activités dominantes des organisations sociales de tout genre (entreprises, administrations, institutions de santé, de formation et du social, surfaces de vente, etc.). Qu'il soit assuré par un service interne ou par une entreprise de nettoyage, l'entretien des lieux est considéré comme un mal nécessaire. Socialement et économiquement dévalorisé, il est délégué à une main-d'oeuvre peu ou pas qualifiée et issue des classes sociales matériellement défavorisées. Ainsi, plus on s'élève dans la hiérarchie sociale et professionnelle, moins les personnes sont confrontées à la nécessité de s'occuper elles-mêmes de l'élimination de la saleté. «Sale boulot» (Hughes, 1996b), le nettoyage est également un boulot sale : il touche au sale et à ce qui dégoûte et son accomplissement implique de se salir les mains. La question de savoir qui doit nettoyer et qui peut s'en préserver revêt donc une importance cruciale. La ligne qui sépare les personnes qui nettoient de celles qui ne nettoient pas traverse les rapports sociaux de sexe, de classe et de race : dans la sphère privée, les hommes gardent plus facilement les mains propres que les femmes, les femmes des classes aisées plus facilement que les femmes des classes populaires et les femmes migrantes ; dans la sphère professionnelle, les Suissesses se préservent mieux que les étranger-e-s, les personnes qualifiées mieux que celles qui n'ont pas de qualification reconnue sur le marché de l'emploi. Le nettoyage est ainsi majoritairement accompli par des femmes et/ou des étranger-e-s. Il représente une de leur seule possibilité d'insertion sur le marché de l'emploi.
(...)