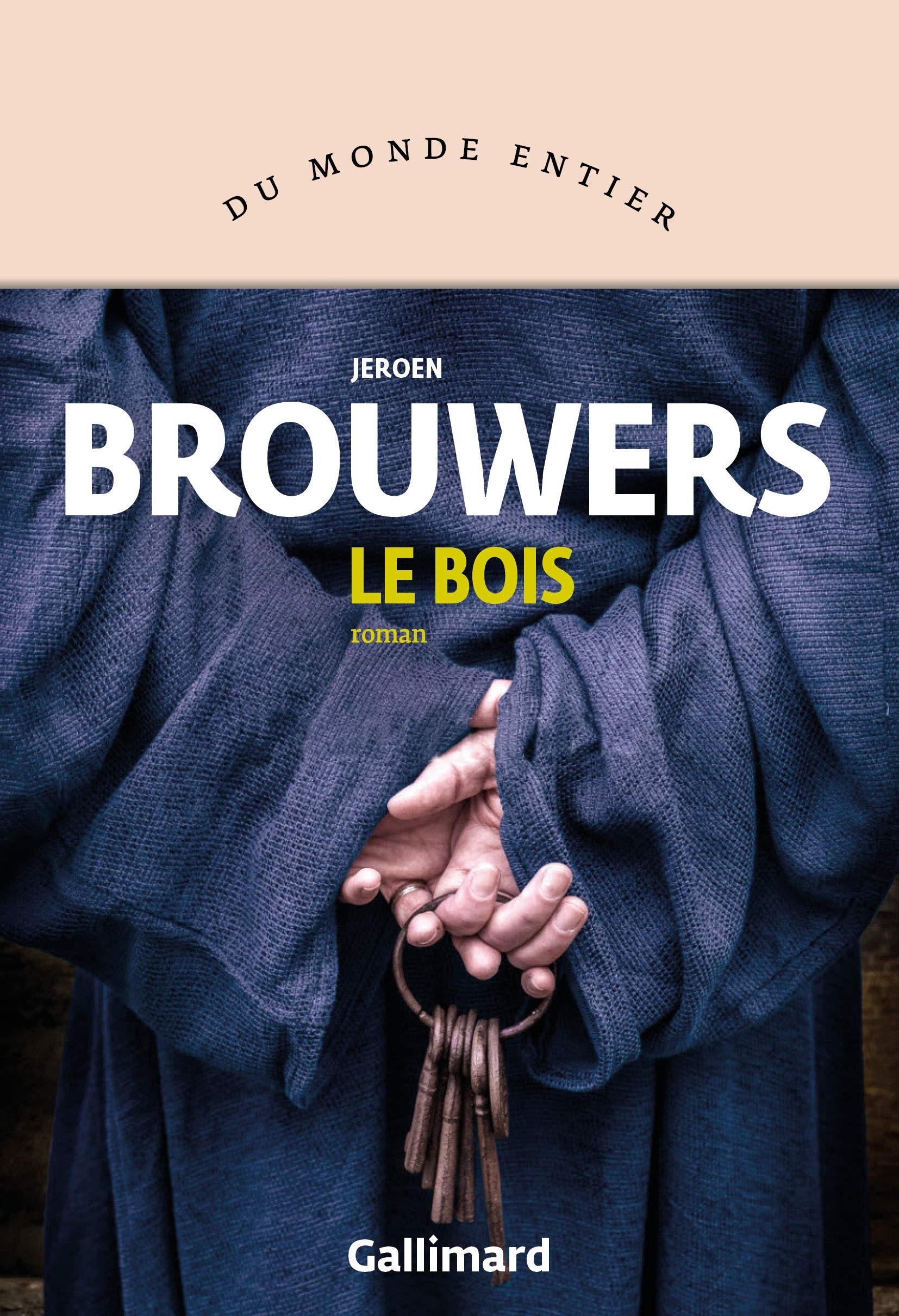Le bois
1953. Dans un pensionnat franciscain du Limbourg, au Sud-Est des Pays-Bas, des moines éduquent de jeunes garçons. Parmi eux, Eldert Haman, rebaptisé frère Bonaventure, a progressivement perdu ses charges d'enseignement pour devenir surveillant et homme à tout faire, sous les ordres de frère Mansuetus, le directeur.
Témoin quotidien de la brutalité et des mauvais traitements imposés aux élèves, Bonaventure découvre un matin qu'un des garçons, corrigé la veille par Mansuetus, manque à l'appel. Redoutant le pire, il mène son enquête dans le pensionnat, et dévoile progressivement tout un système reposant sur la violence et le sadisme.
Le caractère insupportable de ces exactions étouffées va conduire Bonaventure à chercher une manière d'y mettre un terme, alors que lui-même se consume de passion pour une jeune femme qu'il a rencontrée quelques semaines plus tôt.
Roman sur la cruauté humaine et sur la place que l'amour peut jouer quand l'individu tente de résister, Le bois dénonce les abus terribles de quelques-uns tout en interrogeant la part de responsabilité de chacun. Jeroen Brouwers livre avec force une réflexion universelle sur la vie en communauté et le pouvoir de la parole quand il s'agit de trouver son salut.
Extrait
La bure m’irrite la peau.
La robe déguenillée de François d’Assise qui parlait aux loups.
Les moines entrés dans son ordre portent son habit, en forme de croix. Pourvu d’un capuce, il pèse lourdement sur les épaules, descend jusqu’aux pieds et enveloppe tout le corps d’un brun fécal ; l’étoffe en est rugueuse et écorche. Il faut avoir un vêtement de dessous, faute de quoi les démangeaisons, infestant la peau nue tels des termites, vous rendent fou.
Que porte un moine sous son froc? Un sarrau allant jusqu’à la taille, un pantalon de survêtement, un caleçon pourvu d’élastiques ajustables.
Le scapulaire recouvre la robe. C’est une pièce d’étoffe de même longueur, de même matière et de même couleur qu’elle, percée d’un trou à travers lequel passe la tête. Porté sur la poitrine et le dos, comme la chasuble d’un célébrant. Tous les habits sont confectionnés à l’identique, en taille unique, extra-large, si bien que, quels qu’ils soient, ils s’adaptent à chacun.
Le samedi, tout doit être porté au lavage, tâche du ressort de Plechelmus, qui, en échange du linge qu’il reçoit, en distribue du propre. Nous autres, frères, n’avons, à l’exemple de notre fondateur, rien qui nous appartienne, et donc pas non plus de vêtements personnels. Ainsi, au gré du hasard, nous revêtons tour à tour la chemise, le caleçon, le vêtement informe qui couvraient une semaine plus tôt le corps d’un de nos confrères. J’enfreins la règle de l’ordre en ne portant jamais le caleçon communautaire.
Le froc dépenaillé de François est ceint autour de la taille par une corde blanche à trois nœuds rappelant les grands principes qui ont guidé sa vie. Premier nœud: pauvreté. Deuxième nœud : obéissance. Troisième nœud : abstinence ou chasteté. Essayez-vous-y donc un peu ! Il Poverello a laissé des poèmes à ce sujet; ils sont encadrés dans le réfectoire du monastère.
Début avril, mardi de la semaine sainte. Du fait qu’avant-hier, c’était le dimanche des rameaux, des branches de buis frais sont suspendues derrière tous les crucifix et les bénitiers. À peine le printemps, et depuis des jours déjà la canicule, si agressive qu’on croirait que sieur le frère soleil crache sa rage. Une chaleur brûlante, tel du dégueulis en ébullition, qui pénètre tout, même les murs de la chapelle, d’ordinaire fraîche voire froide. Le soleil tonitrue à travers les vitraux figurant des scènes de la vie de saint François, dont les couleurs blêmissent dans la lumière qui s’abat comme un feu. Aussi ardent que celui des fourneaux de Severinus et de son juvéniste qui ne porte pas encore de nom de religion. Si la chapelle est elle-même à peine supportable, comment pourrais-je tenir, dans ma petite chambre sous les toits, où, étouffant sous mon habit, j’assure la surveillance du dortoir, environné par le tapage des garçons dans leurs box.
J’occupe un cagibi de deux mètres sur quatre, cloisonné de parois de contreplaqué, sans plafond. Tant que la lampe, dont l’ampoule a piqué du nez et pendouille à présent toute nue en dessous de l’abat-jour, reste allumée sur ma table, elle projette une tache lumineuse rectangulaire sur le plafond du dortoir, au-dessus de mon réduit. Une petite boule de faible puissance. Rien en comparaison de la fureur de l’astre solaire, et pourtant, la chaleur, qui, même durant la nuit, ne quitte pas mon habit, semble émaner de ce lumignon. Je fixe du regard sa lueur mate et j’ai soif, mais le thermos rempli de thé par l’aide-cuisinier de Severinus est vide: il ne contient plus la moindre lichée. Contrairement à moi : tout le thé froid amer que j’ai bu à petites gorgées ruisselle de mon corps à grosses gouttes — misérable corps, je m’écoule de la tête aux pieds. Je me suis dépouillé de mon sarrau et de mon pantalon, ainsi que du scapulaire et de la corde, mais, bien sûr, pas de ma robe. L’entrée de mon box, semblable aux autres, consiste simplement en un court rideau qui s’arrête à environ cinquante centimètres du sol. Tout élève qui sort de son lit — ce qui est strictement interdit sauf pour une raison impérieuse — peut voir mes pieds nus dans les sandales franciscaines. Je ne saurais, en tant que surveillant, découvrir davantage mon corps. Je suis assis, nu dans mon habit, dévoré de partout par la rugosité de la bure, comme si je vivais dans un sac de jute. J’essaie de ne pas bouger et de faire en sorte que la tente en poil de chameau entre le moins possible en contact avec ma chair, chair méprisable, que je devrais flageller avec la corde à nœuds. Ce dont je me garde bien.
J’ai éteint la lampe. Halos derrière les yeux, je regarde par la fenêtre, qui est ouverte, quoique j’aimerais mieux la laisser fermée pour empêcher la chaleur d’entrer.
La nuit est une masse noire de touffeur explosive. Aucune étoile n’est visible. Sœur lune n’est pas là non plus. Au-dessous de moi s’étend la cour de récréation avec ses marronniers. En face de sa partie dallée se dresse le bâtiment scolaire, au deuxième étage duquel de la lumière brille encore à travers la fenêtre la plus à droite. C’est là que se tient Mansuetus, qui prononce son nom Mansououétouss. Le directeur du collège. Des garçons de douze à seize ans, dix-sept ans, que je suis chargé de surveiller, dans ce dortoir.