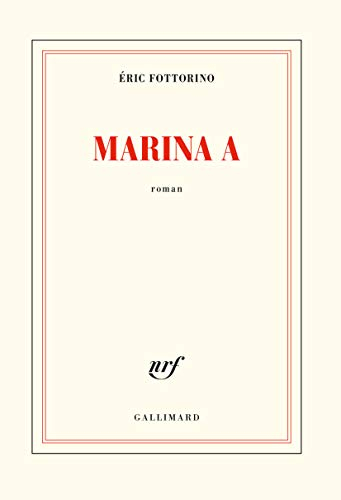Marina A.
En 2018, découvrant par hasard une rétrospective des oeuvres de Marina Abramovic, Paul Gachet ressort fortement ébranlé par tout ce qu'il a vu. Cette performeuse serbe connue dans le monde du body art doit sa réputation sulfureuse à des performances spectaculaires dans lesquelles elle a souvent mis sa vie en danger en (mal) traitant son corps comme un objet.
Chirurgien orthopédiste, les mutilations de Marina A le choquent. Mais aussi, il se surprend fasciné, voire obsédé, par cette femme, par ce qu'elle semble voir lui dire, dire à l'humanité entière, à travers son étrange parcours artistique. Celui-ci, au fil des années, va tendre vers une recherche d'harmonie avec l'autre.
Surtout après sa rencontre avec son compagnon Ulay, dont elle sollicite à l'extrême la confiance, par des gestes extrêmes - un baiser à s'étouffer, leur fusion en un seul être par leurs cheveux noués, une flèche pointée à bout portant vers le coeur de Marina - ou par des regards soutenus des jours entiers sans repos. Jusqu'à l'apothéose d'une performance au Moma de New York en 2010 où des centaines de milliers de visiteurs voudront croiser le regard noir et fixe de Marina A.
Deux ans plus tard, en 2020, Paul Gachet repère dans une revue une photo ancienne de Marina A et d'Ulay intitulée l'Impossible rapprochement. Prise en 1983 à Bangkok, elle montre deux êtres qui voudraient se toucher mais en sont mystérieusement empêchés et doivent rester à distance l'un de l'autre. Alors qu'éclate la pandémie planétaire, Paul Gachet croit percevoir dans les performances de Marina A un pressentiment de la catastrophe, comme si les manifestations de cet art étaient une alerte dont il saisissait enfin toute l'importance. Une incitation à protéger l'autre, à refonder nos sociétés sur ces deux petits mots : « après vous ».
Cette « rencontre » avec Marina A et son univers bousculent profondément le regard de Paul Gachet sur sa relation à autrui. Une inconfortable prise de conscience des dégâts de l'individualisme occidental qui a fini par nous dénaturer. En lui révélant une humanité fragile mais forcément solidaire, Marina A l'a réveillé.
Extrait
Je dirai pour commencer qu’il y a trois jours encore je ne savais rien de Marina Abramovic. Je n’avais jamais lu ni entendu prononcer ce nom qui, en cherchant bien, m’évoquait plutôt un oligarque russo-israélien acoquiné à Poutine et défrayeur de chronique pour s’être offert le club de foot de Chelsea. J’aurais été bien incapable de préciser à quoi ressemblait Marina Abramovic, si elle était brune ou blonde ou platine ou que sais-je, quelle était sa nationalité, même si la sonorité de son patronyme et l’apostrophe finale adoucissant le « c » en « tch » trahissait une origine de l’Est. J’ignorais aussi dans quel domaine elle s’était fait remarquer puisque, je le répète, je ne la connaissais pas. Je ne peux d’ailleurs en rien affirmer que je la connais à présent, physiquement en tout cas, n’ayant jamais croisé son chemin. Pour être plus précis, même si j’ai conscience de mes approximations, c’est plutôt elle qui s’est mise en travers de ma route à plusieurs reprises, sous forme d’affiches géantes, de reproductions de son visage me fixant droit dans les yeux à l’arrière ou sur le côté des bus électriques qui desservent le vieux centre de Florence. Ou encore au coin de certaines rues, en hauteur, là où les Italiens aiment placer des niches peuplées de madones, de pietà et de christs aux mains trouées. Il m’est arrivé, levant les yeux, de tomber sur ce qui ressemblait à un autoportrait déformé de cette inconnue, le visage gondolé comme s’il avait pris toute l’eau du ciel ou des torrents de larmes.
Cet hiver-là, entre Noël et le premier de l’An, j’avais décidé d’emmener Maud et notre fille Lisa, qui fêterait bientôt ses quinze ans, à Firenze, ainsi que la nommaient les guides. Échapper quelques jours à la grisaille parisienne, revoir les jardins suspendus de Boboli – je les avais connus vingt ans plus tôt avec une autre femme, dans une autre vie –, nous perdre dans la galerie des Offices, monter à l’assaut du Duomo et de ses marches pour contempler le Ponte Vecchio enjambant l’Arno, notre programme était tout tracé. S’y ajoutaient quantité de Botticelli, les marbres époustouflants de Michelangelo, les veines délicates au bras de David, les palazzi des derniers Médicis, et bien sûr une orgie de pasta, de panini divins – rien à voir avec nos cochonneries sans goût –, de dolce au citron arrosés de mascarpone. Je précise que mon goût immodéré pour le chocolat chaud crémeux avait fait de Florence la destination obligée de cette fin d’année, même si l’hiver trop clément – à se demander si cette saison avait disparu du calendrier pour cause de réchauffement – gâchait un peu le plaisir de se retrouver devant une tasse fumante et noire sans que le thermomètre extérieur tutoie « les voisins du zéro », comme disent les accros de la roulette.
J’essaie de me rappeler la première fois où le visage de Marina Abramovic est entré dans mes yeux. C’est facile. Nous marchions depuis une bonne heure dans les travées du marché central, entre les stands de fromages et de charcuterie, de pâtes multicolores et de plateaux en bois d’olivier garantis cent pour cent toscans. Maud s’était mis en tête de dénicher une râpe à parmigiano digne de ce nom, moyennant quoi on se retrouva les bras chargés de sacs en plastique remplis de victuailles pour une légion romaine. Pesto, spaghetti et ustensile de dosage des spaghetti, spatule – en authentique olivier aussi – trouée de cercles de plus en plus larges (pas ceux de l’enfer, bien que la gourmandise y menât tout droit), selon qu’on en voulait pour une, deux ou trois personnes, poudre de truffe blanche, biscuits aux amandes et raisins secs, au cacao, morceau généreux de pecorino, jambons de toutes les vallées voisines, bidons rebondis d’huiles d’olive au litre : la vue de ces trésors de bouche vantés par la belle langue italienne des commerçants nous avait ouvert l’appétit en grand. J’avais avisé un escalier qui donnait accès à l’étage très animé du marché. Là, d’immenses tables accueillaient les consommateurs qui, n’y tenant plus devant ces amas de trésors, commandaient des assiettes remplies de tout ce qui rend la vie belle sur le coup de midi, poulets rôtis et patates sautées, pizzas à la demande, dans une odeur mêlée d’oignons, d’origan et de viande qui cuit, et de chianti pardi, ou de ces blancs de Toscane qui brillent dans les verres !
C’est à ce moment qu’elle m’apparut. J’étais occupé à déchiqueter à pleines dents la chair d’un demi-poulet quand je sentis sur moi un regard noir et fixe. L’affiche, une immense photo, la représentait les cheveux tirés en arrière, la bouche recouverte d’une feuille d’or. Une intensité inhabituelle se dégageait de cette image. Était-ce sa dimension, était-ce la fixité de ses yeux sombres ou la pâleur de sa peau ? La taille de son nez droit et pointu, son nez cap et pic et péninsule ? Cette présence immobile me fit arrêter d’un coup de mastiquer. Malgré mon italien défaillant, je comprenais qu’elle se produisait au Palazzo Strozzi depuis septembre. Son nom apparaissait en grosses lettres rouges, avec en dessous cette mention énigmatique, The Cleaner, que je traduisais bien sûr comme « la nettoyeuse ». Mais que, ou qui, nettoyait-elle ? Je songeai vaguement qu’elle pouvait être une grande cuisinière, si douée pour préparer des plats sublimes qu’on en léchait son assiette. J’étais loin de la vérité, mais au milieu de cette profusion de victuailles il était difficile de penser à autre chose qu’à manger. Une autre affiche, tout aussi imposante, la montrait dans un plan plus large, vêtue d’un ample habit blanc, la chevelure séparée en deux par une raie bien tracée, une bougie allumée dans une main, l’index de l’autre main posé sur la flamme, et noirci à la première phalange.
Il fallait s’approcher pour remarquer un reflet cristallin au creux de son œil, et sur sa joue deux perles transparentes, des larmes minuscules mais qui, une fois repérées, changeaient la physionomie de l’ensemble. Ces larmes, je ne voyais plus qu’elles. Il fallait que quelqu’un éteigne cette flamme, éteigne cette femme. Moi, peut-être.