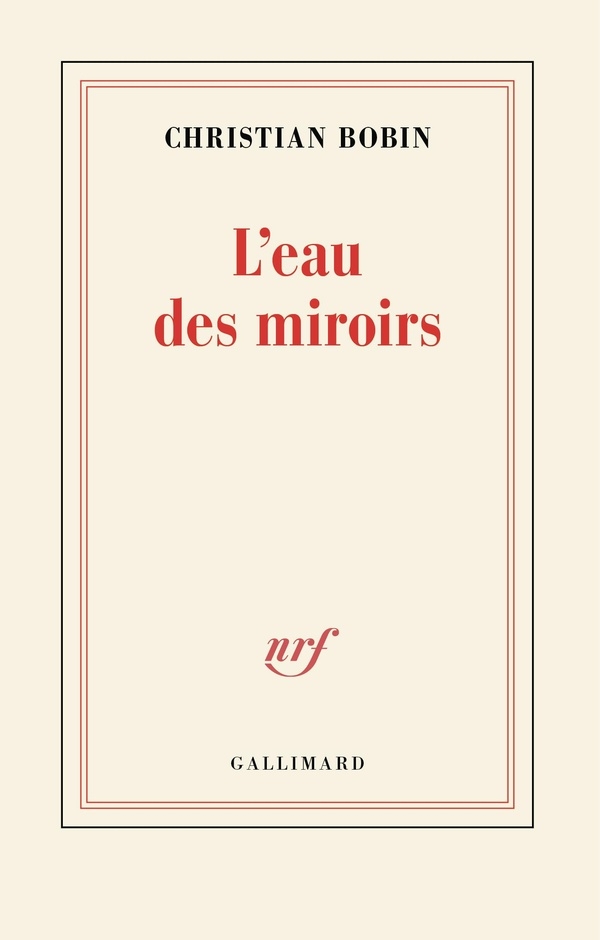L'eau des miroirs
L'eau des miroirs est un récit poétique, sans doute le premier par lequel Christian Bobin, alors jeune poète, prend sa voix. Or, c'est une femme qui nous parle. Elle se meurt, délaissée par son amant. Et tandis que la mort froide s'étend sur elle, elle raconte l'amour qui l'a liée à un homme vivant reclus parmi ses livres. De cette situation très romanesque sourd déjà toute la richesse de l'oeuvre en gestation : la rupture avec le monde, les mots du désir charnel, la nature salvatrice où s'abandonner. Ce livre agit telle une naissance - violent, tendre, essentiel.
Extrait
C’est avec le stylet que tu m’avais offert, et dont j’usais pour ouvrir les pages de ces vieux livres que j’aimais tant, que je viens, doucement, de m’ouvrir les veines. Je n’ai pas relevé les manches de ma robe. La lame s’est enfoncée d’abord dans le tissu, puis dans la peau, enfin dans la chair profonde. Je suis allée du plus lointain au plus proche. La résistance diminuait progressivement, devenait bientôt nulle : j’ai très bien senti le sang surgir, ruisseler, tiède comme un duvet, comme une écume de mûres ou de framboises. Comme une fleur qui se déploye, légèrement incisée par le premier soleil.
Pendant une seconde je n’ai rien vu. Le sang s’attardait autour des lèvres de la blessure, puis se faufilait sous le vêtement : dans ma main creusée pour les recueillir apparaissaient des gouttes, noires, brillantes. La rosée qui recouvre les plaies lorsque revient le matin. L’absence.
J’ai essuyé le stylet contre ma cuisse. Métal fin, poisson des eaux sans lumière. Hier encore je m’en servais pour libérer des pages scellées ensemble. Pour que les mots cachés au regard s’envolent, voltigent et se posent sur la fenêtre, sur mes épaules. Aujourd’hui, c’est ma douceur qui s’évade, qui me fuit. Petite rivière rouge et chaude qui va vers la mer, qui rentre dans la terre, qui m’entraîne à son gré… Je suis allongée sur le lit. Je n’ouvre pas les yeux. Je pourrais mais je ne le fais pas. Je peux sentir la lumière. Une lumière égale, lente, poudreuse comme du pollen. Elle vient par pétales sur mes paupières closes, sur mes mains qui flottent au bout de mes bras. Je n’attends pas. Je n’attends plus.
Comme si le sang était de la terre, et la terre s’en va : je me sens légère, peu à peu allégée. Une tendresse étrange, entière. Semblable, oui, semblable à celle qui m’étouffait et me délivrait lorsque tu me prenais contre toi, lorsque tu me serrais si fort…
Un peu au-dessus du coude, dans l’intérieur du bras, là où la peau est blanche comme une pâte, quelque chose m’élance, me tire. Les pinces d’un insecte. Les dents très sûres d’une belette. Vagues. Vagues de coton, de lin, de fougères qui s’enroulent et se déroulent dedans ma tête, s’écrasent à l’arrière de mes yeux, du côté noir du corps, du côté aveugle. Tout cela par instants. Aussi du silence. Beaucoup de silence…
Mourir a un goût de pomme. Le pommier est en fleur, le pommier est en feu. Trois demoiselles entreront dans le jardin et tu danseras avec elles. La première aura les cheveux de la neige et la deuxième les lèvres du vent. La troisième rira très fort. Trois demoiselles viendront dans ton jardin et ce sera l’hiver…
Je n’appellerai pas. Qui viendrait ? Ma main droite, celle qui t’écrivait et te dessinait des déliés de caresses, celle qui touchait ton visage dans le noir, en aveugle, ma main droite est rouge et ne saurait plus, même en creux, susciter ta présence, l’esquisse de toi. Les pierres et les bêtes aussi, comme la chair, comme la peau, doivent saigner lorsqu’on ne les voit plus, lorsque la terre et le ciel se sont retirés d’elles et qu’elles se découvrent depuis toujours abandonnées. L’absence est un vide, un vertige qui n’en finit pas de tenter, un gouffre que rien ne signale, qui ne donne sur aucune terre, sur aucun sol, qui ne finit ni ne commence rien, rien. Le cœur se fane, se recroqueville. Bois mort qu’un rien embrase, consume. Je brûle. Je me noye. Je ne sens rien.
C’est long. Plus long que je ne pensais. Ce qu’il faut de temps pour que le temps cesse… La mort lèche le liquide chaud qui sort de moi, le lait, l’eau, la sueur. Jusqu’à la lie. Jusqu’au très amer blotti contre les parois du corps. Lorsque je me serai dépouillée de toutes mes ombres, de toutes mes fraîcheurs, alors seulement la lumière pénétrera en moi, d’un seul coup, d’une seule lance. La lumière étrangère à toute vie, qui suinte des murs d’hôpitaux, des lits des malades. Blancheur des draps et des corps qui sont dans les draps et des yeux dans les corps. Blancheur des voix, des bruits de l’extérieur. Un extérieur exsangue, épuisé lorsqu’il parvient dedans les chambres. Blancheur du sang. Sérum, sang de fantômes, sang pâle, comme la farine, comme le marbre. Soleil des mourants, lumière sèche, stérile. Bientôt plus rien ne me distinguera des vivants. Comme eux je serai morte. Comme eux je serai calme, raisonnable. Le néant et l’absence où je vais m’abîmer coïncideront avec leur monde, avec ce qui fait leur monde, ce rien. Je n’ai jamais eu affaire avec ces gens. J’ai profondément haï leurs passions pour l’inessentiel, leurs accommodements de tout, la servitude à quoi s’abandonnaient leurs pauvres amours. Ils n’accueillaient rien qu’ils ne l’aient au préalable corrompu, compromis par leur grossièreté, par leur aisance vulgaire, leur habileté à faire de tout une raison de durer. Ce qui les faisait vivre me faisait mourir. Déjà, petite fille, je les reconnaissais : leurs enfants leur ressemblent, comme eux familiers de la force, comme eux épris de l’évidence et ignorants des mystères, n’y voyant que des ombres à réduire, à chasser. J’eusse aimé parfois que l’on me tue, que l’on m’enfonce les yeux dans le crâne, que l’on brise mes membres, comme une poupée, que l’on me jette dans la plus profonde nuit. Qu’on me soulage, enfin, de cette légèreté, de cette vie que la vie annulait, violentait sans cesse. Un écureuil me rongeait le cœur. Une souffrance. Aujourd’hui je ne fais que reprendre une mort ancienne, déjà accomplie.