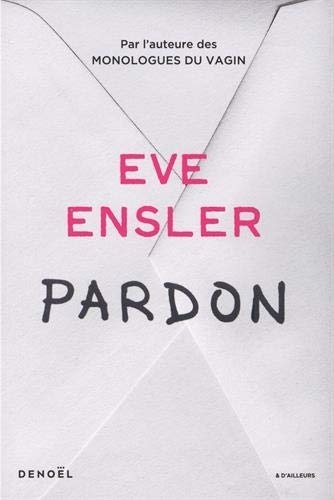Pardon
Comme des millions de femmes, Eve Ensler a attendu sa vie entière des excuses qui ne sont jamais venues. Son bourreau, qui fut aussi son père, est mort sans exprimer aucun regret. C'est ainsi qu'Eve a décidé d'écrire elle-même cette demande de pardon tant espérée. Derrière les mots fantasmés de son père, c'est peu à peu la vie d'Eve, ses luttes et ses passions qui transparaissent. Se dessine le portrait d'une femme incroyablement courageuse qui est parvenue à trouver une voie alternative à la honte et à la colère. Pardon est un texte salvateur qui a suscité à sa parution aux Etats-Unis la même onde de choc que Les Monologues du vagin.
L’attente est pour moi terminée. Mon père est mort depuis longtemps. Ces mots, il ne me les dira jamais. Il ne me demandera pas pardon. Il faut donc l’imaginer. Car c’est notre imagination qui nous per- met de franchir les limites, d’approfondir le récit et d’inventer des issues nouvelles. Cette lettre est une invocation, un appel. J’ai per- mis à mon père de me parler avec ses mots. Même si j’ai rédigé moi-même ce que j’avais besoin d’en- tendre de lui, j’ai dû lui ménager un espace pour se manifester à travers moi. J’ignore énormément de choses de son histoire, qu’il ne m’a jamais confiées, j’ai donc dû aussi les élaborer. Au travers de cette lettre, j’entends essayer de doter mon père de la volonté et des mots du repentir, de façon que je puisse enfin être libre.
Extrait
Chère Evie,
Comme il est étrange de t’écrire. Est-ce que je t’écris depuis la tombe, depuis le passé ou le futur ? Est-ce que j’écris en ton nom, tel que tu voudrais que je sois, ou bien tel que je suis vraiment, avec ma propre compréhension limitée des choses? Et est-ce que ça a une quelconque importance? Est-ce que je t’écris dans une langue que je n’ai jamais parlée, que tu as créée à l’intérieur de nos deux esprits afin de combler les failles, les manques de communication? J’écris peut-être depuis mon être authentique, celui que tu as libéré en te portant témoin. Ou bien je n’écris rien de tout ceci et suis simplement utilisé comme vecteur de tes propres besoins, de ta version des faits.
Je ne me rappelle pas t’avoir jamais écrit. Des lettres, j’en envoyais rarement. Pour moi, rédiger une lettre, tendre la main aux autres, eût été un signe de faiblesse. Les gens m’en écrivaient. Pour ma part, je n’aurais jamais laissé qui que ce soit penser qu’il comptait assez à mes yeux pour que je lui en écrive une. Cela m’aurait rabaissé, mis dans une position désavantageuse. Même te l’avouer me fait bizarre. Ce n’est pas quelque chose dont j’aurais conscience, normalement, ou que je dirais, à moins que tu aies pénétré mon cerveau. Mais je ne le contesterai pas. C’est vrai, je le sens.
Des lettres, tu m’en as toujours écrit. Je trouvais ça curieux et étrangement émouvant. Nous habitions la même maison, pourtant tu m’écrivais, de ta petite main d’enfant qui tentait de tracer des lignes droites mais qui zigzaguait dans tous les sens sur la page. À croire que tu essayais d’entrer en contact avec la part de moi que tu ne trouvais pas dans les épisodes houleux de notre différend. Tu essayais, par le biais de la poésie, de faire appel à un moi secret dont je t’avais autrefois autorisé l’accès. En général, tu écrivais des lettres d’excuses. Il est tellement logique que tu veuilles à présent en recevoir une de moi. Tu t’excusais sans cesse, tu implorais mon pardon. Je t’avais réduite à cette rengaine quotidienne, dégradante : « Je suis désolée. »
Un jour, je t’ai privée de dîner et envoyée dans ta chambre, et t’ai forcée à y rester le temps que tu comprennes et avoues ta mauvaise conduite. Tu t’es entêtée et tu as gardé le silence vingt-quatre heures durant. Ta mère s’inquiétait. Mais tu as dû avoir faim, ou trouver le temps long. Tu m’as écrit une lettre sur une fiche du pressing où je faisais nettoyer mes chemises. Tu l’as glissée sous la porte de ma chambre. C’était un long plaidoyer. Une liste, en fait. Tu as toujours aimé les listes. Je pense que tu avais besoin de cataloguer les choses, de les élucider en une sorte d’arithmétique littéraire.
C’était une liste de tout ce que tu avais appris et ne referais plus jamais. Je me souviens que le mensonge venait en tête. Tu ne mentirais plus jamais. Et je savais déjà pourtant, tout en m’acharnant jour après jour à te faire croire que tu étais une méprisable menteuse, que tu étais la petite fille la plus honnête que j’aie jamais connue, même si des petites filles, je n’en connaissais pas beaucoup. Je détestais les enfants. Ils sont bruyants, sales et mal élevés. Cette lettre, sur ce carton, ton écriture fiévreuse au feutre mauve, ces fleurs biscornues que tu avais dessinées sur les côtés, t’a permis de sortir de la chambre, et je me demande à présent si c’est pour cette raison que tu as continué d’écrire, comme une sorte de passeport pour la liberté.
Depuis que j’ai quitté le monde des vivants, je suis coincé dans une zone des plus désespérante. Elle ressemble trait pour trait à ce qu’on dit des limbes : un vide, une oubliette. Les limbes, pas un lieu en tant que tel. Fondamentalement, je ne suis nulle part. Je flotte, sans attache, à la dérive. Il n’y a rien ici, rien à voir, pas d’arbre, pas d’océan, pas de son, pas d’odeur, pas de lumière. Il n’y a pas de lieu au sens où on l’entend, pas d’enracinement, rien à quoi se raccrocher. Non, rien, si ce n’est le reflet de ce qui m’habite.
« Qu’est-ce que l’enfer ? L’enfer, c’est soi-même. »
C’est une citation de T. S. Eliot. Tu ne le sais peut-être pas, mais c’était mon poète préféré. Ses mots me reviennent souvent, dans ces limbes. J’erre ici depuis près de trente et une années humaines, mais là où je me trouve, c’est curieux, il n’y a pas de temps. Seulement un vide atroce, un espace insatiable, à la fois effroyablement vaste et totalement étouffant.
J’ai quitté le monde des vivants ivre de ressentiment et de rancœur. Même sur mon lit de mort, ma colère était plus puissante que le cancer qui consumait mon corps. Ma rage était si pernicieuse qu’elle se manifestait en dépit de la morphine et du delirium, me donnant la force de mettre en œuvre mes ultimes châtiments. Et ta pauvre mère, que pouvait-elle faire? Je l’avais terrorisée pendant de si nombreuses années, l’assommant de mes cris, de ma condescendance et de mes menaces, qu’à ce stade elle n’était plus qu’une complice apeurée et dévouée. Elle s’efforçait de m’apaiser. Elle me répétait que ce n’était peut-être pas le moment de prendre des décisions extrêmes. Elle a tout fait, sauf me dire que j’avais perdu la tête.
Mes toutes dernières pensées, mes tout derniers souffles ont été imprégnés du désir de faire mal, le désir de provoquer une longue souffrance. Peut-être l’ignores-tu, mais en cet ultime instant j’ai insisté pour qu’elle te raie de mon testament. Tu n’hériterais de rien. «Rien!» Je l’ai dit avec force. Même dans l’état de faiblesse qui était le mien, cette vengeance m’animait. C’était ma dernière chance de t’abolir, de t’éradiquer, de te punir.
Et lorsque ta mère m’a demandé de revenir sur ma décision, j’ai insisté : tu l’avais cherché. Pourquoi laisserais-je quoi que ce soit à une enfant si têtue et déloyale? L’opposition de ta mère m’a plongé dans une fureur encore plus grande, et je suis devenu plus vindicatif, tentant d’effacer jusqu’à ta nature. Je l’ai forcée à me promettre que, quoi que tu lui dises une fois que je serais parti, elle ne te croirait jamais, car il était de notoriété publique que tu étais une menteuse éhontée. Menteuse. J’ai forcé ta mère à s’engager à te retirer toute sa confiance et à douter éternellement de toi. Je l’ai forcée à t’éliminer comme je t’avais éliminée. Je l’ai forcée à choisir entre son mari et sa fille. Mais ce n’était pas nouveau. Elle était bien exercée à ce sacrifice. Je l’avais exigé d’elle la majeure partie de ta vie. Et je savais parfaitement à quel point elle se méprisait d’avoir accepté. Je le voyais à la façon dont, au fil des années, j’avais érodé son amour-propre de mère, effacé son assurance et sa voix. Je voyais que je l’avais rendue si faible qu’elle n’avait plus de respect pour elle-même, qu’elle ne se reconnaissait plus, et pourtant j’insistais encore.
J’ai passé la première de ces innombrables années au royaume de la mort à repasser en boucle toutes les trahisons et les déceptions que j’avais subies, la bêtise ou la faiblesse dont avaient fait preuve mes collègues, mes enfants et mes prétendus amis. Une année à ressasser ma haine et à exiger la vengeance. Bien sûr, tu étais haut placée sur la liste.
J’ai quitté le monde si furieux contre toi que je t’ai punie en refusant de t’informer que j’étais en train de mourir. Je ne t’appellerais pas pour te faire mes adieux. Je voulais que les bris de ma rage te coupent, te fassent saigner, te forçant à me transporter partout, dans une hémorragie de culpabilité et de désespoir, à te demander pour le restant de ta vie pourquoi tu n’avais jamais été à la hauteur, n’étais jamais devenue la fille que j’attendais que tu sois.
Déterminé à te laisser sans mot de la fin, sans conclusion, j’ai refusé qu’on organise un service commémoratif, ou des funérailles. Je trouvais ça vulgaire, ces étalages pathétiques d’absurdités et d’émotions inutiles. Et puis, si tu portais le deuil de moi, tu risquais de parvenir à me laisser aller. Le refus était le seul pouvoir qu’il me restait, la seule façon de me saisir de ton être et de conserver ton attention pour toujours.
Quelques jours après ma mort, avant d’entrer dans ce royaume, je t’ai épiée. Tu étais assise par terre dans mon dressing en Floride, mon vieux pull en cachemire jaune pressé contre ton visage. Je n’ai d’abord pas compris ce que tu faisais, puis me suis rendu compte que tu me reniflais, tu inhalais mon eau de Cologne, mon odeur, en quête d’un lieu pour abriter ton deuil. Et, malgré moi, ça m’a touché. Ça m’a ramené à une époque où il y avait de la douceur entre nous, une époque baignée d’une affection presque intolérable. Te voir ainsi sur le sol de mon dressing, à essayer de me retrouver, a soulevé en moi une vague de manque et de tristesse — et je suis parti. Parti de ton monde, parti de la beauté, parti de la possibilité du salut. Jeté dans le ressassement des offenses et des griefs.