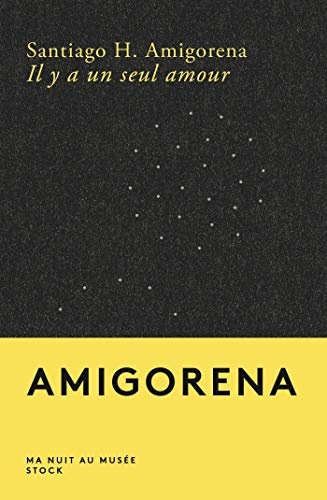Il y a un seul amour
Il y a un seul amour.
Ou plutôt, n'y a-t-il qu'un seul amour ? Parle-t-on du même amour pour une œuvre ou pour l’être aimé ? Qu’en est-il de notre amour ? semble adresser Amigorena à celle qu’il aime et qui ne sera pas auprès de lui cette nuit. N’a-t-il pas déjà écrit tout au long de sa vie sur des musées, des expositions, des peintures ? Oui, cette promenade nocturne au musée Picasso sera donc une tentative de s’extraire de l’amour, de prendre la distance nécessaire pour tenter d’y mettre des mots.
Justement les mots, il les dépose, les juxtapose et joue avec. Au cœur du musée endormi, les interrogations deviennent des affirmations, les affirmations des interrogations. Tenant résolument le fil de l’amour, Amigorena attend, dans le sommeil et les rêves, que les œuvres le guident et lui apportent quelques réponses. Dans cette nuit de solitude forcée, où s’invitent Picasso, Giacometti ou encore Vermeer et Bataille, il explore avec pudeur et profondeur le sentiment amoureux, l’écriture, les œuvres, et ce qui inextricablement les lie.
Extrait
L’amour a-t-il une histoire ? Peut-il être étudié, annoté, disséqué ? L’amour est-il une suite d’événements qui peuvent former un récit, une chronique ? Peut-on rendre compte de l’amour ? Peut-on en faire le compte rendu ?
Ou est-ce plutôt inévitablement une fable, un mythe, la matière d’une nouvelle, d’un roman, d’un poème ?
Aimer se mérite-t-il, se gagne-t-il ? Aimer est-il un prix – ou a-t-il un prix ?
Et qu’en est-il d’« être aimé » ? Être aimé est-il une satisfaction, ou une sanction ?
Peut-on chercher l’amour ? Peut-on le trouver ? Peut-on aimer un être comme on aime un paysage, un goût, un parfum, une musique, un livre – un tableau ?
L’amour est-il un, ou est-il multiple ?
Peut-on apprendre à aimer ?
L’amour est-il physique ou métaphysique ? L’amour est-il une affaire de larmes ou de joie ? une affaire de caresses ou de coups ? une affaire de corps – ou de mots ?
Et peut-on aimer deux êtres en même temps, comme on aime deux dessins, comme on aime deux tableaux ?
L’amour peut-il finir ? L’amour peut-il commencer ?
L’amour peut-il se conjuguer ? « J’aimerai » peut-il signifier qu’un amour existera dans le futur ? Et que veut dire « j’aimai » ?
– Peut-on « avoir aimé » ?
*
Peut-on avoir aimé ou n’y a-t-il (de même qu’il y a un seul océan, de même qu’il y a une seule nuit pour tous les enfants, de même qu’il y a un seul ciel pour tous les êtres qui lèvent leur regard vers le firmament) qu’un seul amour, qu’un seul amour qui nous emporte, qui nous déborde, plein de vagues, de remous, d’étoiles et de trous noirs – un seul amour qui déferle et nous submerge, et qui s’apaise furieusement et qui sagement se déchaîne ?
Peut-on avoir aimé ou espérer qu’on aimera un jour, ou n’y a-t-il qu’un seul amour possible : l’amour présent ?
*
Aimer est-il un métier – comme vivre est un métier ?
*
Je marche et je me pose ces questions, que je te pose aussi.
Sans doute, puisque je t’aime, tu serais la seule à pouvoir me dire ce qu’aimer veut dire.
Sans doute, puisque je t’aime, tu seras la seule qui ne me le diras jamais.
*
Malgré tous mes efforts, ma réflexion ne parvient pas à saisir l’amour : il ne m’en reste que la contradiction.
*
L’amour est-il vraiment si semblable au temps ?
– Plus j’aime, moins je sais ce qu’est aimer.
*
Par où commencer alors ? Par le milieu ? Par la fin ? Par ce début éternel qui me fait t’aimer chaque jour davantage et qui chaque jour davantage te fait douter de mon amour ?
Ça va faire trois ans que nous nous aimons et que nous luttons pour cet amour. Pour et contre cet amour. Contre et pour cet amour. Trois ans sans victoire, sans trêve, sans repos. La bataille est si furieuse, si désordonnée, si confuse, si incertaine, et nos cœurs sont si inextricablement entortillés, et nos corps si indémêlablement enchevêtrés, que dans cette lutte acharnée nous savons à peine qui est qui.
À part, peut-être, et jamais je ne pourrai te convaincre de la tristesse de ces mots, – à part que c’est moi qui écris.
*
À part que c’est moi qui écris, et que je me donne donc ici, dans les mots, le droit de raconter notre histoire telle que je la vois, le droit de raconter ma manière de voir, ma manière de nous voir, de nous voir tous les deux : toi telle que tu es seulement à mes yeux, moi tel que je ne le serai jamais aux tiens.
Oui, c’est moi-même qui me donne le droit aujourd’hui, dans un moment de calme, de calme et d’espoir, de commencer à raconter notre histoire par ce soir si particulier, de commencer ou de m’en tenir plutôt, à résumer, à concentrer, à condenser l’histoire de notre amour dans ce soir si singulier puisque pour la première fois depuis des mois nous étions tous les deux à Paris et nous n’allions pas dormir ensemble : ce soir lointain où je devais te quitter, ce soir où je devais m’éloigner de ta douceur, de ta tendresse, de ta passion – et de notre violence – pour aller passer la nuit seul au musée Picasso.
*
Ce soir où l’amour de la peinture allait tenter d’apaiser l’amour de t’aimer.
*
En partant de la maison, je n’avais aucune idée de pourquoi au juste on m’avait proposé de passer la nuit dans ce lieu que je connaissais à peine – et encore moins des raisons qui m’avaient poussé à accepter cette offre insolite. Dès mon arrivée, on m’avait expliqué ce que je pourrais et ce que je ne pourrais pas faire pendant les longues heures de solitude nocturne qui m’attendaient dans ce bâtiment glacial : jusqu’à minuit, j’allais avoir le droit d’errer dans les salles désertes ; de minuit à six heures et demie du matin, j’allais être prisonnier du hall de l’escalier d’honneur.
Surveillé par deux statues de Giacometti – une grande Femme assise située au-dessus de ma tête et un grand Marcheur sombre debout face à moi –, j’allais pouvoir écrire sur un minuscule bureau ou dormir dans un sac de couchage étendu sur un lit de camp.
*
C’était si étrange de songer que cette nuit-là j’allais dormir dans un sac de couchage, sur un lit de camp, à l’ombre de ces deux grands bronzes, à quinze minutes à pied de la douceur de tes bras !
*
J’espérais – éperdument, déraisonnablement, sans espoir – que la nuit serait douce : que je m’endormirais tôt et que les monstres impérissables de Giacometti réussiraient à apaiser mes rêves et à éloigner de mon esprit mes monstres à moi, familiers et menaçants, éthérés et imprévisibles – fourbes et fugaces, comme toutes les armes qu’on tourne soi-même contre sa poitrine.
*
Juste avant que je ne quitte la maison, tu m’avais souri et je t’avais embrassée. Il y avait quelque chose d’un grand départ, d’un départ à la guerre, d’un départ sans retour, dans ce petit départ au musée. Tu avais peur, comme chaque fois qu’on se sépare ; j’avais honte, comme chaque fois que je t’abandonne.
Mais j’étais parti. J’étais parti et j’avais marché sombre dans la pénombre des rues qui me séparaient du Marais. La curiosité d’aller errer seul parmi des œuvres d’art n’était pas assez forte pour calmer l’émoi de t’avoir blessée ni la peur de devoir passer une nuit entière loin de toi, mais j’avais marché, j’avais marché en m’éloignant inexorablement de ton regard gris qui, omniprésent, commençait d’envahir le ciel gris de la nuit.
J’avais descendu la rue Jean-Pierre Timbaud les yeux rivés sur mes pieds, la moue renfrognée, comme un enfant qui a cru, après son premier jour de cours, que c’était bon, que c’était fini, que plus jamais il ne devrait retourner à l’école – et à qui on dit, le lendemain matin, qu’il doit y aller chaque jour.
J’avais marché, marché, marché, et marché encore, mais mon corps ne désirait qu’une seule chose : revenir vers la douceur perdue de ton corps, de tes mots, de ton regard – ton regard aussi profond que la nuit et aussi doux que la pluie.