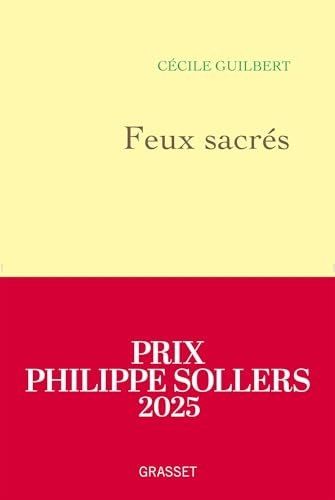Feux sacrés
À 20 ans, Cécile Guilbert est une jeune étudiante débridée qui ne jure que par la poésie, la littérature et la philosophie. À ses oncle et tante qui lui parlent de yoga, de gourou et de spiritualité hindoue, elle réplique que ses maîtres se nomment Nietzsche, Baudelaire, Lautréamont, et qu'elle ne comprend rien à leurs histoires de Shiva et de vedas. Trente-cinq ans plus tard, c'est dans l'appartement d'un maître yogi qu'elle réapprend à respirer pour survivre à un choc traumatique. Comment la rationaliste sceptique s'est-elle transformée en disciple appliquée ? Par quelles rencontres de chair et de papier ?
Dans ce récit initiatique intime dont la langue claire et l'implacable franchise mêlent ironie, intelligence et ardeur, Cécile Guilbert traverse sa vie vitesse grand V pour raconter les épreuves et les joies qui ont rendu possible cette métamorphose. Car pour s'ouvrir à cette Vita Nova, il lui faudra affronter plusieurs fois le scandale de la mort : celle de son cousin adoré, suicidé ; de sa grand-mère veillée dans son agonie ; de son oncle à qui elle ira dire adieu dans un ashram du Kerala ; de son petit frère dont le cadavre est découvert dans des circonstances dramatiques. Il lui faudra découvrir l'amour vrai avec Nicolas, la lumière dans le regard des sages, les bûchers de Bénarès, se croire brisée chaque hiver pour finalement renaître à elle-même.
À mille lieux de nos repères et nos idées, elle nous emporte dans un grand voyage qui fait briller les feux sacrés de sa constellation personnelle : l'amour, les morts, l'Inde et les livres. Faisant aussi la part belle à la magie poétique des signes par lesquels chacun peut donner sens à son existence, Feux sacrés pourrait aussi se résumer ainsi : Savoir mourir, s'éveiller, apprendre à renaître pour mieux vivre.
Extrait
Novembre, encore. La grisaille, le froid, les paquets de pluie battant les verrières dans la nuit tombée à cinq heures du soir. Et toujours cet appel des ombres qui me font signe le jour et disparaissent la nuit.
Ceux qui m’aiment organisent des réjouissances pour la Sainte-Cécile le 22 et mon anniversaire le 29 ? Ils ignorent que ces dates n’ont jamais empêché mon âme de geler à partir de novembre où je ne fais que tomber malade en attendant que tout ce que j’aime reprenne vie et couleurs.
Ce soir-là, installée près d’un feu de cheminée dont j’espérais que ses joyeux crépitements dévoreraient les atomes de mélancolie vaporisés dans l’atmosphère, je n’avais pas encore reçu le coup de fil de ce vieux copain qui m’apprendrait que sa femme s’était suicidée la veille. Je ne savais pas qu’après s’être levée, nourrie, douchée, vêtue comme toujours avec élégance et maquillée avec soin, cette ravissante quinquagénaire avait enjambé la fenêtre de son dressing pour se jeter dans le vide et s’écraser, quatre étages plus bas, dans la cour intérieure de son immeuble. J’ignorais aussi qu’après avoir vu les pavés de granit où s’étaient fracassés l’ossature de Tanagra et le visage de porcelaine de S., je serais hantée par des images manquantes qui me plongeraient des semaines durant dans une noirceur plus intense encore que celle qui, chaque année, déteint sur l’hiver.
Pour l’heure, je me réchauffais aux flammes et tuais le temps en feuilletant les pages glacées d’un magazine quand un article retint mon attention. D’après son chapeau, le cadavre d’un prince indien avait été retrouvé dans les ruines d’une bâtisse noyée dans l’épaisse végétation d’une forêt de Delhi. Illustrant le papier, une petite photo montrait une pièce aux murs sales, au sol de ciment brut, meublée seulement d’un châlit recouvert d’une cotonnade usée et d’une petite table de rotin surmontée du portrait peint d’un vieillard enturbanné.
La combinaison de ces deux informations – le texte et l’image – rameuta en moi des souvenirs suffocants. Et soit que j’eusse voulu dans l’instant les chasser de mon esprit ou les épingler pour m’en repaître, le fait est que je plongeai avec avidité dans la lecture de l’article.
D’après les faits rapportés une semaine plus tôt par le Hindustan Times, l’homme retrouvé – un certain Ali Raza – se faisait appeler « prince Cyrus » et prétendait être issu d’une famille royale ayant régné depuis plus de 2 500 ans sur l’Oudh, un fief du nord de l’Inde annexé au milieu du XIXe siècle par les Britanniques. Il était aussi question de sa mère, Wilayat Mahal, qui suite à l’incendie du palais que Nehru leur avait concédé, à Srinagar en 1948, après la partition du pays, avait décidé d’occuper la salle VIP de la gare de New Delhi, au début des années 70, afin d’obtenir que le gouvernement la reloge avec son fils et sa fille.
Une sacrée bonne femme, cette bégum. Très attachée à ses privilèges. Une tête de fer qui, accompagnée de ses deux enfants, avait opiniâtrement campé pendant presque dix ans au milieu du fracas des locomotives et des foules bigarrées. Installée avec ses domestiques népalais et ses chiens, ses porcelaines de Chine et ses tapis persans, elle avait tenu audiences et remué ciel et terre avant d’obtenir d’Indira Gandhi ce pavillon paumé dans une forêt où elle se suiciderait vingt ans plus tard, en avalant ses diamants réduits en poudre.
Quant au prince Cyrus, seul survivant de sa famille après le décès de sa jeune sœur dans des circonstances demeurées mystérieuses, il avait continué d’y vivre reclus pendant vingt ans, hantant tel un spectre ce fantôme de palais ouvert à tous vents, sans eau courante ni électricité, où un feu de bois cuisait sa pitance sous les portraits vermoulus de ses ancêtres. Et voilà qu’à 58 ans il était mort à son tour dans ce même galetas où surnageaient, ainsi que l’énumérait l’article dans un inventaire digne de Jacques Prévert ou Boris Vian, « une bicyclette, une glacière à pique-nique, une radiocassette, une machine à écrire cassée, un sabre rouillé, des cartes de visite de journalistes étrangers et de diplomates, des tapis usés et des sonnets en ourdou du poète Mir Babbar Ali Anis ».
Cette histoire, ce destin, ces détails si romanesques et jusqu’à cette collection d’objets hétéroclites me firent tomber dans une rêverie profonde comme au fond d’un puits. Et tant d’années plus tard, alors que je n’en suis toujours pas sortie, je sais que cet événement appartient à tous ceux qui composent ce récit.