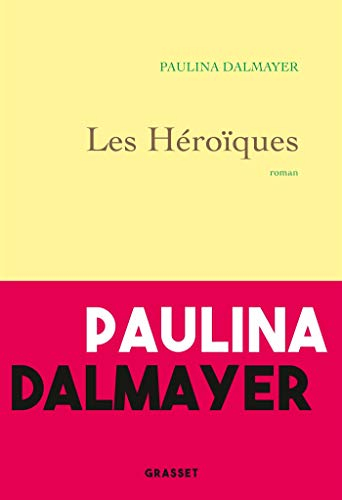Les héroïques
Quelques jours de la vie d’une femme, Wanda. Les derniers, et les plus intenses, peut-être ?
A 70 ans, Wanda est l’audace incarnée. Atteinte d’un cancer généralisé, elle sait sa fin imminente. Son état se dégrade à vue d’œil, mais dans cette course contre la montre, pas question de se laisser abattre, encore moins d’avoir peur. Plutôt aller de l’avant, aujourd’hui comme hier, en ces temps de sa jeunesse que Wanda se remémore : le concert des Rolling Stones à Varsovie, en avril 1967, où elle rencontre Edward qu’elle épousera et dont la brillante carrière accompagnera les paradoxes de l’Histoire polonaise contemporaine ; son engagement dans une troupe de théâtre expérimental ; sa passion pour Konrad, son étudiant devenu amant après la chute du mur ; et bien sûr ses deux filles, insaisissables et lointaines.
Face aux assauts du siècle, à sa violence, aux renoncements idéologiques, Wanda et ses proches ont toujours cultivé l’ironie et tenté de préserver ce qu’il restait de beauté. Héroïques à leur façon et nourris d’utopies, ils ont su rester libres. C’est à cette liberté que Wanda n’entend pas renoncer. Elle décide de s’évader de l’hôpital où elle était soignée, convaincue qu’il existe des lieux autrement plus recommandables pour trépasser. Et si son histoire commençait là où on la croit achevée? Et si, jusqu’au bout, il était possible de relancer les dés ?
Une fabuleuse leçon de cran, d’intelligence et de vie, portée par une langue vibrante et réjouissante.
Extrait
Cent. Quatre-vingt-dix-neuf. Quatre-vingt-dix-huit. Quatre-vingt-dix-sept. Quatre-vingt-seize. Quatre-vingt-quinze. Quatre-vingt-quatorze. Soixante-huit. Soixante-huit… Comment se fait-il qu’à soixante-huit ans, mon corps refuse de m’obéir ? Je compte à rebours, comme c’est recommandé, en expirant très lentement. Parfois je parviens jusqu’à quatre-vingt-dix, avant de sombrer. Que faire pour résister ? Je me laisse fléchir, perds complètement le fil, dors profondément. Enfin, je n’en sais trop rien. Parfois, l’impression troublante de me promener dans mes propres vaisseaux sanguins m’accompagne jusqu’au réveil. Égarée dans l’artère plantaire médiale de mon pied gauche, je peine à remonter vers l’artère tibiale et le haut de mon corps. Par où suis-je sortie pour me retrouver soudain en lévitation sous le plafond ? Mystère. Je plane au-dessus de mon effigie que je sais pourtant être ma chair vivante. Je l’observe d’en haut, fébrile, toute en moiteur, parcourue de légers tressaillements. Embarrassée à l’idée d’être surprise à flotter ainsi dans l’air, je me précipite – ou plutôt, comment dire ? –, je me hâte de descendre, de revenir en moi. C’est par le patch de morphine que je me réintègre. Ensuite, tout se passe de manière ordinaire. J’ouvre les yeux, fixe le lustre, et sens l’odeur des œufs brouillés au bacon qu’Edward carbonise dans la cuisine en écoutant les informations sur Radio Zet. Prise de nausées, je manque de temps pour reconstituer le voyage entre le moi d’ici-bas, immobilisé par la lourde couette d’hiver, et cet autre moi, libre de se balader à travers mon système sanguin ou de le quitter, de s’envoler vers un monde conjectural, spéculatif, sinon chimérique. Ai-je été empêchée de me déplacer au-delà du plafond ou n’ai-je simplement pas gardé en mémoire la suite de mon odyssée ?
*
Gabriela, ma fille aux mains d’enfant rongées par l’essence de térébenthine, dirait « trip », imaginant que je ne connais pas le mot. Elle me croit dépassée, fossilisée même, dans un préjugé formaliste contre tous ces anglicismes qui nous racontent le meilleur des mondes depuis la chute du Mur. Je ne lui en veux pas. Que l’on me montre un enfant qui sache discerner un être humain derrière la figure parentale ! Ma présumée méconnaissance de la novlangue n’est d’ailleurs qu’un détail, parmi les anachronismes que m’attribuent l’une ou l’autre de mes filles. Car, selon Marta, la cadette, ma démission de la faculté de médecine aurait été motivée par mon incapacité à nouer le dialogue avec les étudiants. Je l’ai entendue dérouler toute une analyse érudite et habile à ce sujet, au téléphone avec son père. Au bout de quarante ans de vie commune, Edward a la nonchalance de mener les conversations téléphoniques le haut-parleur enclenché. Quant à Marta, pas une seconde elle n’a imaginé que je puisse être lasse. En vérité, l’année où Konrad venait en cours aura sans doute été la dernière où j’ai eu le sentiment d’avoir transmis un savoir. C’était il y a vingt ans. Depuis, rien. Que des imbéciles qui m’ont demandé s’ils devaient prendre des notes quand j’ai introduit Kant dans un cours sur le syndrome néphrotique. Au moins se doutaient-ils qu’il ne s’agissait pas de l’inventeur d’un quelconque vaccin. À présent, alors que mon cancer se généralise, je ne les juge pas aussi sévèrement. Avec ou sans Kant, on a peur, on a mal, et généralement cela suffit pour qu’on ne se préoccupe pas de questions qui relèvent de philosophie pratique. « Que dois-je faire ? »
Je n’en sais fichtrement rien.
Il fait jour. J’ai toujours des nausées et une grande envie de vin blanc. Un blanc sec et bien frappé. Après-demain, Edward repartira à Strasbourg. Et si je n’attendais pas son départ pour commencer à picoler du blanc au petit déjeuner ? Il n’en serait pas choqué. Le risque étant qu’il se serve un verre de whisky pour accompagner ses œufs au bacon. En fait, je tolère mal les commentaires d’Edward, surtout quand il me signale sur un ton de nigauderie bienveillante que j’ai ronflé. « Délicieusement », précise-t-il. J’ai délicieusement ronflé. L’apparition de mes premières métastases osseuses a transformé Edward en un benêt exalté à court de superlatifs flatteurs. Jamais de mon vivant, enfin, du temps d’avant le cancer, je n’ai été aussi « délicieuse ». Espèce de baratineur ! Fauché chaque soir par un sommeil d’ivrogne, Edward n’est que le témoin factice de mes nuits. Sobre, il ne supporterait pas que je ronfle. Et puis, je ne ronfle pas. Peut-être que je gémis. Je serais prête à l’admettre. Mais le but de mes exercices de respiration n’est ni de ronfler ni de gémir. Je compte à rebours pour me détendre, harmoniser ma respiration, ralentir tout processus vital en moi. Sans résultat. Il se pourrait que les méthodes de respiration orientales ne soient pas adaptées au tempérament polonais. Au lieu de m’apaiser, je me laisse happer par les miasmes du passé. Les promenades opiacées à travers mon système sanguin me ramènent invariablement à la maison, au jour précis, et dont je me souviens très bien, contrairement à ce que je m’efforce de nier. Le plafond ne m’arrête pas.