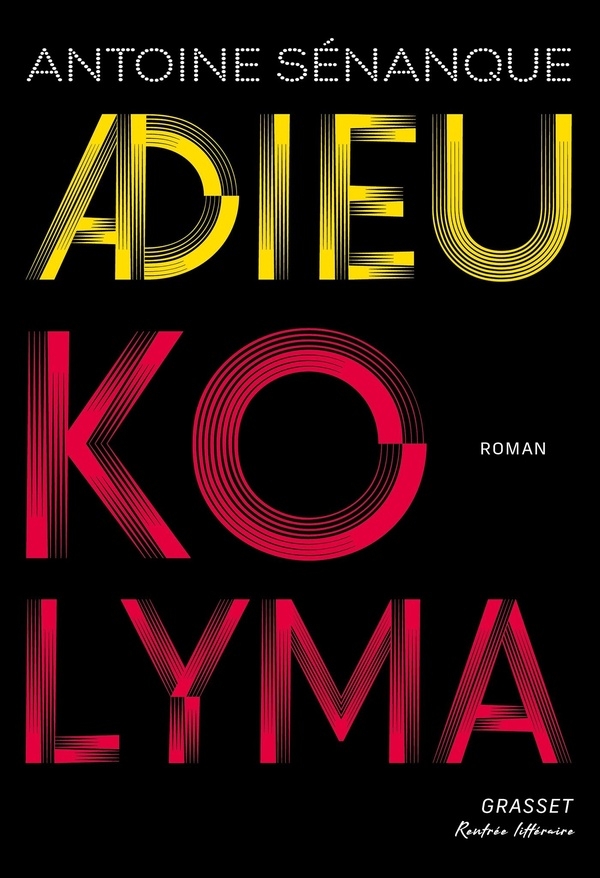Adieu Kolyma
Kolyma : grand Est Sibérien, aux confins extrêmes de la Russie, où le froid atteint -60°C. C'est ici, le long de ces rivières, que les pires camps du Goulag stalinien furent construits. Ici aussi que Sylla Bach, l'héroïne de ce roman, est devenue « la tueuse de chiennes ». Internée neuf ans à la Kolyma, elle fut le bras armé des truands et des hommes du NKVD lors des grandes purges, puis celui des frères Vadas, chefs de l'impitoyable famille des transylvaniens à la tête des mines d'or de la région.
Quand le roman démarre, nous sommes en 1956 : Staline est mort depuis trois ans, les camps disparaissent, restent les mines. Tous les personnages du livre sont revenus vivants de la Kolyma : Sylla Bach ; Varlam, le vieux bolchevick qui l'a recueillie dans un orphelinat du Caucase et qui l'a formée ; les frères Vadas, Pal et Lazar, dont la haine réciproque tisse les fils de l'action ; Kassia, l'infirmière que Sylla a rencontrée et aimée là-bas. Parce qu'elle aurait trahi le clan, Sylla est condamnée à survivre dans les décombres de cette ville où la révolte vient d'être matée et à aimer Kassia de loin, en la protégeant sans qu'elle le sache. Elle la croyait à l'abri mais la sortie de prison de Lazar Vadas va réveiller les haines et l'obliger à reprendre la route et les armes pour aller retrouver sa liberté. De Budapest écrasée par les chars russes en passant par Kiev et Moscou, tous les personnages se retrouveront là où pour eux tout a commencé et tout devra finir : à Magadan, coeur de la Kolyma.
Exceptionnel et entêtant, Adieu Kolyma nous transporte dans l'une des régions les plus désolées du monde pour y jouer les dernières notes de la sonate Sylla Bach et mettre en scène un drame shakespearien dont tous les éléments sont présents : l'amour, la mort, la guerre ; les liens du sang rompus, la loi des clans trahie et les corps désunis. En mêlant les vies et le sang de ses personnages, Antoine Sénanque peint le portrait brûlé par la glace de l'inoubliable Kolyma.
Extrait
Kolyma
Dans une correspondance avec Alexandre Soljenitsyne, après la lecture d’Une journée d’Ivan Denissovitch, décrivant le quotidien d’un prisonnier dans un camp de travail soviétique, Varlam Chalamov lui demandait :
« Où est ce camp merveilleux ? En mon temps, j’y aurais bien passé ne fût-ce qu’une petite année. »
Les deux témoins les plus célèbres de la terreur stalinienne ne se comprenaient pas.
Quand Soljenitsyne voyait dans le Goulag un lieu d’asservissement où la rédemption restait possible, Chalamov n’y trouvait qu’un enfer construit pour une irrémédiable damnation.
Le premier aurait pourtant proposé une coécriture de sa grande œuvre : L’Archipel du Goulag, mais Chalamov déclina l’honneur.
On dit que c’est un chat qui détermina son refus. Ce chat, qu’il avait vu passer, bien portant, dans une des pages du roman, l’aurait convaincu que leurs expériences ne pouvaient s’accorder. Selon lui, le chat d’Ivan Denissovitch aurait été dévoré par les bagnards de la Kolyma et aucun animal, autre que les chiens du NKVD, n’y aurait survécu.
C’est une carcasse que Chalamov aurait voulu trouver dans les pages écrites par un témoin réaliste de la vie concentrationnaire.
On dit aussi que Soljenitsyne s’était rendu coupable d’un oubli difficile à pardonner pour un lecteur aussi radical. Une réalité essentielle des camps, passée sous silence et source d’une angoisse sans mesure aussi destructrice que les mines où l’on envoyait les détenus creuser leurs tombes.
Cette réalité, c’étaient les clans, la pègre qui collaborait avec le système à l’entretien de la terreur, par le racket, les humiliations, les tortures et les assassinats.
« On ne peut comprendre le camp, sans connaître le rôle qu’y ont joué les truands. C’est justement ce monde des truands, ses lois, son éthique et son esthétique qui ont infesté de corruption l’âme de tous ceux qui s’y trouvaient. »
Le chat et l’oubli des clans scellèrent le désaccord irréversible entre les deux écrivains. Mais en réalité, ils ne traitaient pas du même sujet.
Soljenitsyne parlait du Goulag, Chalamov de la Kolyma.
La Kolyma est une région singulière. Aux confins de l’Extrême-Orient sibérien, elle est le lieu le mieux défendu de la terre.
À la vie humaine, elle n’apporte rien que de l’obscurité, du froid et de la négation.
À l’entrée de son territoire, elle ne commande pas d’abandonner toute espérance, comme au visiteur des enfers. Elle ne châtie pas. Elle ignore. Elle refuse de reconnaître les présences en elle.
Puisque ceux qui l’ont traversée n’y ont rencontré que la souffrance et la mort, on pourrait croire que les offrandes de chair humaine conviennent à son goût. Mais dans ce cas, elle s’en nourrirait, ce qu’elle ne fait pas.
Aucun mort ne pourrit jamais dans le cœur de la Kolyma, aucune parcelle de chair ne retourne à la terre pour alimenter un cycle de vie. Le permafrost n’accepte pas les corps, il les rejette congelés, sans les dégrader, sans rien leur prendre, comme des bouts de glace impurs à écarter.
Certains pensent qu’elle aurait plaisir à voir mourir ceux qui la foulent. Cela expliquerait que ses rivières regorgent d’or. Elle attiserait ainsi l’avidité des habitants de la terre et les pousserait à y venir planter leur croix.
Les prospecteurs font courir ces légendes, mais les anciens bagnards, eux, le savent : la Kolyma n’a ni volonté, ni sentiment.
Elle est le lieu du rien.