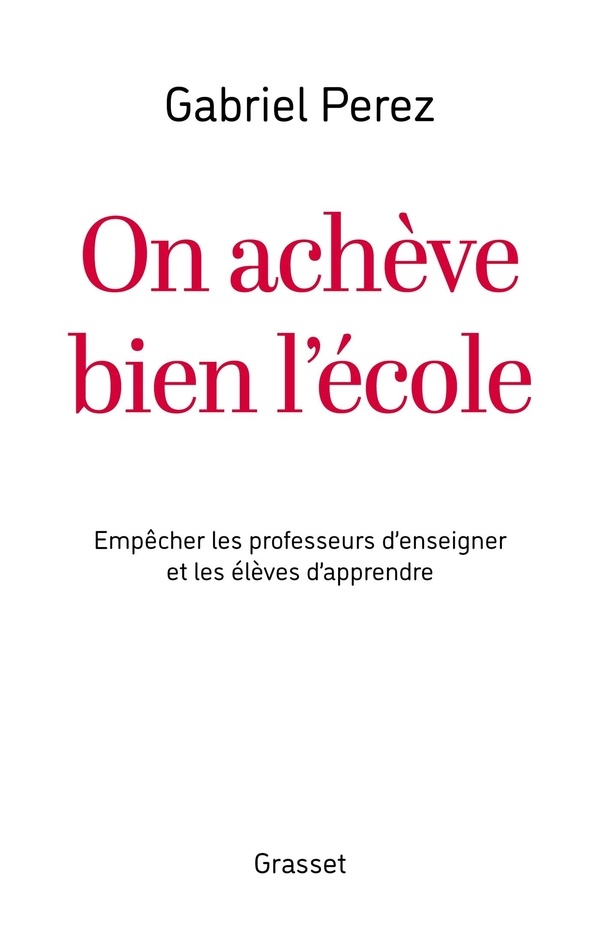Le crépuscule de l'école
« À l’Éducation nationale, une révolution a eu lieu. Une révolution sans nom, dissimulée par une stratégie du puzzle qui assemble avec patience les pièces des réformes avant d’en dévoiler l’image d’ensemble : remplacement des filières historiques du lycée par des spécialités “au choix” ; passage du baccalauréat national en contrôle continu ; admission des élèves de lycée dans le Supérieur abandonnée aux algorithmes de la plateforme Parcoursup. Un nouveau mode de gouvernance est né : celui des évaluations généralisées et de la concurrence entre élèves, enseignants et établissements.
Dans la novlangue ministérielle, on prétend avoir bâti le “lycée des possibles”. Du côté des enseignants, c’est une tout autre réalité que je découvre : celle d’un monde éducatif où, pour préserver ses conditions de travail et grimper dans les classements, la falsification des notes et le clientélisme sont devenus les nouvelles normes. La fin de la société du mérite s’accomplit sous nos yeux : elle empêche désormais les professeurs d’enseigner et les élèves d’apprendre.
Une énigme philosophique transforme le destin de ce livre en enquête : la révolution organisationnelle de l’école n’est-elle pas le prélude d’une révolution politique ? » G.P.
Extrait
Le bon, la brute et le truand
Une restructuration organisationnelle, c’est toujours la mise en œuvre d’un scénario. Dans le réel, cependant, c’est autrement plus tragique qu’au cinéma. L’Éducation nationale, version Blanquer, n’est cependant pas un scénario original. C’est un remake. Une histoire qui commence au tournant du millénaire, alors que l’État décide de transformer en profondeur l’organisation des services publics et de ses monopoles historiques.
France Télécom, à ce titre, est le parangon de cette épopée. La toile de fond qu’il faut garder à l’esprit pour reconnaître les procédés de réécriture.
À France Télécom, tout commence un soir d’octobre 2006, à la Maison de la chimie à Paris. À la tribune, Didier Lombard (le PDG), Louis-Pierre Wenès (le numéro deux), et Olivier Barberot (le DRH) annoncent comment ils comptent opérer une « transformation profonde » de l’entreprise : « Olivier Barberot va vous parler de ce qu’on a en tête, détaille Lombard. Ce sera un peu plus dirigiste que par le passé. C’est notre seule chance de faire les 22 000 [départs]. » Il ajoute, sans trembler : « En 2007, prévient-il, je les ferai d’une façon ou d’une autre, par la fenêtre ou par la porte. » Vingt ans plus tard, on sait que ça s’est surtout fait « par la fenêtre*1 ». Prête à en découdre, la trinité directoriale se surnomme elle-même « le Bon, la Brute et le Truand ». La Terreur, dans sa version contemporaine, peut commencer.
Une fois la trame du nouveau western annoncée en grande pompe, le tournage démarre. Pour virer à tour de bras, Cruauté personnifiée procède au recrutement de sa jumelle, Créativité. Virer en masse, ça exige de faire preuve d’imagination. Les services des ressources humaines lancent alors un programme à destination exclusive des managers, histoire de leur apprendre à peaufiner leurs méthodes de licenciements sauvages. On s’y échange les « trouvailles », les « stratégies », les « trucs », pour dégraisser. On attend qu’un cadre vivant à Montpellier ait son deuxième enfant pour lui proposer une promotion aux Antilles, faute de quoi, s’il refuse, on sera contraint de le rétrograder à un poste sans intérêt ; on félicite chaleureusement une manageuse qui a atteint ses « objectifs », alors que celle-ci a juste perdu des collègues décédés d’un cancer. Bref, on brise des carrières. On humilie. On isole. On remplit les placards. Faut que ça dégage. La banalité du mal, institutionnalisée.
En toute simplicité rhétorique, avec un goût pathologique pour les acronymes douteux, ce programme de licenciements massifs est baptisé NEXT – pour « Nouvelle Expérience des Télécoms ». Celle-ci, enseigne-t-on, consiste surtout à expérimenter la perte d’emploi – laquelle est alors théorisée sur le modèle de la courbe de deuil décrite par les psychiatres*2. C’est donc « normal » si un salarié est au bord du suicide, se rassure-t-on. « Ça va passer. »
Le dénouement, chacun le connaît à présent : la dépression des agents rétrogradés ; les suicides en série ; un procès retentissant ; la reconnaissance juridique d’un « harcèlement institutionnel ». La constitution d’une mémoire collective. Avec l’espoir, vain, qu’il s’agit là d’« un cas à part »