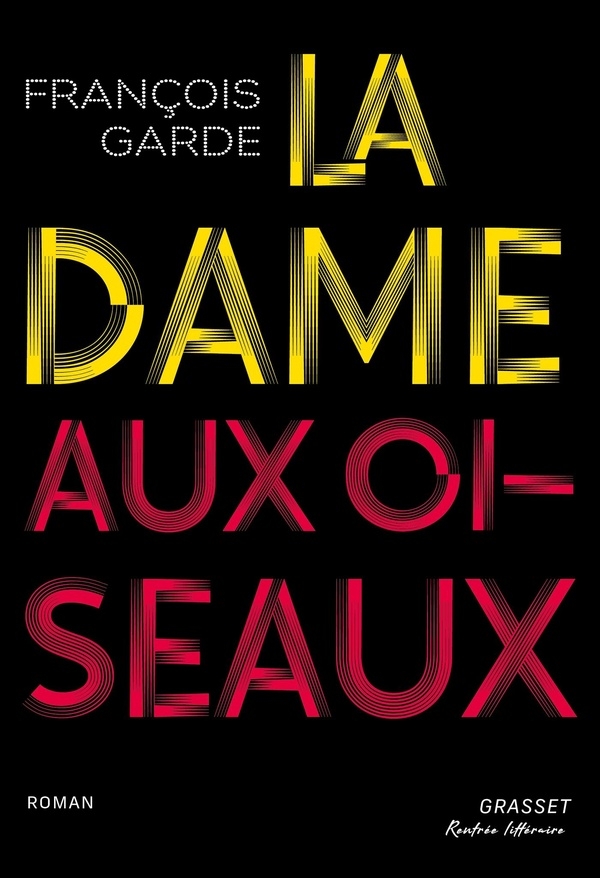La dame aux oiseaux
Un petit village du bord de mer sous un ciel atlantique…
Quatre principaux protagonistes.
Tom, un jeune électricien, orphelin d’un père qu’il n’a pas connu, revient au pays pour y retrouver sa mère Annie, ouvrière retraitée et y prendre la gérance du bar de la Jetée rebaptisé Le Cap Horn.
Élise, veuve sexagénaire recluse dans la Maison de la Pointe, qui se promène depuis trente ans sur les mêmes plages pour y ramasser inlassablement les oiseaux morts.
Et le vieux Léon, agriculteur, ancien d’Algérie, intermédiaire entre les vivants et les morts qui le visitent parfois…
Pourquoi la « dame aux oiseaux » vit-elle sans aucun contact avec les habitants du village ? Et quelle étrange obsession l'a-t-elle poussée à son rituel quotidien?
Que s’est-il passé il y a trois décennies pour que ressurgissent soudain des brumes les secrets du passé qui précipitent aujourd’hui les drames : un accident -criminel ? -, un coupable - innocent ? - un suicide - mais pourquoi ?
Élise, Tom, Annie et Léon prennent tour à tour la parole. Les quatre voix se complètent ou se contredisent : chacun détient une parcelle de la vérité - sauf Léon, qui a tout compris mais ne dit rien.
Mélodrame d’ambiance faussement policier et vraiment onirique, ce roman d’atmosphère raconte l’histoire d’un amour flamboyant et fracassé, et des traces qu’il a laissées jusque dans la mémoire de ceux qui ne l’ont pas vécu.
Extrait
Tom
« Les touristes, on est contents quand ils arrivent parce qu’ils apportent des sous. Et on est contents quand ils partent, parce qu’on reste entre nous. »
Chacun au village, quel que soit son âge ou son métier, adhérait volontiers à cette profession de foi. Tous ne l’auraient pas formulée avec autant de netteté, ou à voix haute, mais lorsque Léon assénait sa maxime préférée, les clients du bar acquiesçaient d’un hochement de tête. Objecter, engager une conversation eût été une perte de temps. Le vieil homme, avec son éternelle casquette grise en toutes saisons, ne répondait à personne. Il soliloquait, ou ne discutait plus qu’avec des amis que lui seul voyait et entendait.
Jamais je ne l’ai vu entrer en été. À l’arrivée de l’automne, à partir d’une date que lui seul décidait et qui changeait chaque année, il venait tous les jours s’asseoir à la même table, collé à la fenêtre donnant sur le parking et la jetée. Toujours vêtu d’un pantalon de travail bleu pétrole et d’une veste verte délavée, il restait silencieux, somnolait, buvait un verre de blanc. Il ne dérangeait personne, tant que nul n’usurpait son poste d’observation.
Parfois un touriste égaré hors saison, désireux de boire une bière ou un thé, insolite et esseulé comme un oiseau migrateur qui aurait perdu le goût des voyages, franchissait le seuil pour trouver un refuge contre la pluie ou l’ennui. Léon le fixait alors avec une telle intensité et une telle colère que l’intrus percevait vite l’hostilité qu’il suscitait, sans pouvoir en deviner la cause, et ne savait quelle contenance adopter. Je m’empressais de le rassurer : « Ne faites pas attention, il est toujours comme ça… » Apparemment par souci d’apaisement et d’hospitalité. En fait parce que je ne pouvais me permettre de perdre aucun client, ni cet étranger de passage, ni Léon.
De la mi-avril à la mi-octobre, mon affaire tournait maintenant à son rythme de croisière, mieux que sur les comptes prévisionnels. Je travaillais avec trois saisonniers, sept jours sur sept, du premier café à sept heures au dernier digestif à une heure du matin. Restauration légère à midi et glaces l’après-midi complétaient la carte. Mes annuités d’emprunt ne m’inquiétaient plus, et quand je tombais de sommeil, je me disais : tu dormiras à la morte-saison.
Car la baisse des températures s’accompagnait de celle des recettes. Tout le monde, et d’abord mon banquier, me disait que je n’étais pas raisonnable, que je ferais mieux de fermer durant le long hiver, de me reposer, de partir en vacances. Mais je m’étais promis, en reprenant le bar du village, d’ouvrir toute l’année. Tel était mon projet, ma folie peut-être, ma boussole en tout cas, et je n’entendais pas y déroger. Certes, les heures d’ouverture étaient moins généreuses et je m’accordais le lundi comme jour de repos. Mais je ne cédais rien de plus.
De novembre à mars, dans la tempête ou dans une lumière de fin du monde sur les landes et les marais, quand les jours sont courts et désespérants, que le froid et l’humidité assaillent l’imprudent qui met le nez dehors, le bar devenait le point de ralliement des habitants du village, et bientôt de ceux des villages voisins, que nul concurrent ne me disputait. Les parents d’élèves, les pompiers, les pêcheurs, le club des anciens, la paroisse y tenaient leurs réunions. D’ailleurs, quel autre endroit pour se retrouver et regarder ensemble les grands matches de football, après un enterrement ou une réunion du conseil municipal, en amoureux, après une sortie en mer ou pour jouer à la belote ? De nouvelles habitudes se prenaient, ou plutôt d’anciens réflexes ressuscitaient.
Le bar était devenu le centre discret de la vie sociale du canton. Tout l’arc-en-ciel des sentiments s’y déployait : l’ivresse joyeuse des jeunes, la mélancolie des femmes seules, le réconfort d’ouvriers en pause de leur chantier, le répit pour les pêcheurs juste rentrés de mer, le vin bavard des aînés… Les bagarres n’étaient pas tolérées et valaient aux fauteurs de troubles une exclusion pour une durée dont j’étais seul juge. Au terme de leur punition, ils revenaient, penauds, et ne recommençaient pas.
Un jour qu’il était en veine de confidences, Léon me raconta – ou peut-être ne parlait-il qu’à lui-même, peut-être lui prêtai-je cet après-midi-là une oreille plus attentive – que lorsqu’il était jeune, six bistrots se partageaient la clientèle, et il en récita la liste, comme la litanie d’un culte oublié : l’Étoile du soir, Chez Émilienne, le Rendez-vous des Amis, la Joyeuse Lanterne, le café Vert, le bar de la Jetée. L’exode rural et la télévision les avaient tués les uns après les autres, la Jetée étant le dernier à avoir fermé.