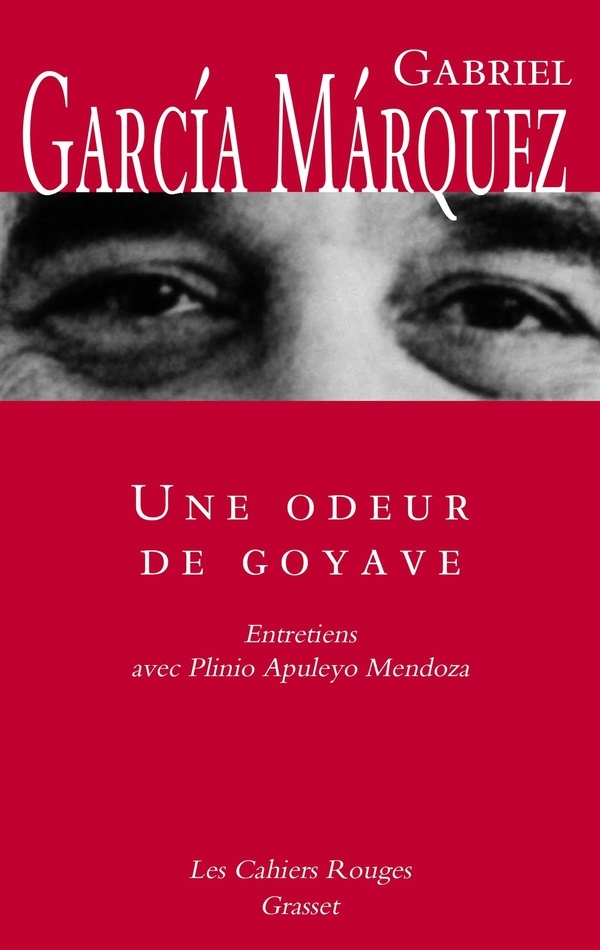Une odeur de goyave: Entretiens
« A mon sens, l'imagination n'est qu'un instrument, bon pour élaborer la réalité. Mais la source de la création, en fin de compte, c'est toujours la réalité. Et la fantaisie, autrement dit l'invention pure et simple, à la Walt Disney, est ce qu'il y a de plus détestable ». Lorsque García Márquez dit cela à son ami Plinio Apuleyo Mendoza, il s'oppose à l'interprétation convenue de sa littérature, suivant laquelle le surnaturel viendrait, comme une épice, relever la réalité dans ce qu'il convient d'appeler un « réalisme magique ». Sa démesure, poursuit-il, n'a rien à voir avec la fantasmagorie, mais elle est à l'image de la celle de son continent d'origine. Le réalisme de García Márquez n'est pas magique, il est sud-Américain.
Dans ces passionnants entretiens publiés la première fois en 1982, année de son prix Nobel, non seulement García Márquez affirme les principes de son art, mais il raconte son enfance, sa jeunesse, sa découverte de Kafka, de Faulkner et de Sophocle, ainsi que la misère, les voyages et les amitiés, avec un sens du détail, une distance critique et un humour hors du commun. Voici les clefs d'une oeuvre dont les secrets résident, à la fin, dans la lecture de chacun.
Extrait
Les origines
Dans son souvenir ce serait un vieux train jaune, lent, toujours enveloppé de fumée. Il arrivait tous les matins à onze heures, après avoir traversé les immenses plantations de bananiers. Tout au long de la voie, sur les chemins poussiéreux, des bœufs traînaient des tombereaux chargés de régimes de bananes vertes. L’air était brûlant et humide. Quand le train s’arrêtait au village, il faisait très chaud et les femmes qui attendaient sur le quai de la gare se protégeaient du soleil avec des ombrelles de toutes les couleurs.
En première classe, il y avait des sièges d’osier et dans les wagons de troisième, qu’empruntaient les journaliers, de rudes banquettes de bois. Certains jours on voyait arriver dans le convoi un wagon aux vitres bleues, entièrement climatisé, qui servait pour les cadres de la compagnie bananière. Les hommes qui en descendaient n’avaient ni la tenue, ni le teint café au lait, ni l’air somnolent des personnes que l’on croisait habituellement dans les rues du village. Rouges comme des homards, corpulents, ils se donnaient, avec leurs guêtres et leurs casques coloniaux, des allures d’explorateurs. Certains venaient avec leurs femmes. Elles semblaient frêles et un peu perdues, dans leurs robes de mousseline.
« Des Nord-Américains », lui expliquait son grand-père, le colonel, avec un rien de dédain, le même dédain qu’affectaient les vieilles familles du village devant tous les nouveaux venus.
À la naissance de Gabriel, la fièvre de la banane n’était pas encore complètement retombée. Elle avait secoué toute la région bien des années auparavant. Avec son train, ses vieilles maisons de bois et ses rues brûlées de soleil, Aracataca avait l’air d’un village du Far West. Elle avait aussi ses mythes et ses légendes. Vers 1910, quand la United Fruit avait installé ses bâtiments à l’ombre des plantations, le village avait connu une ère de splendeurs et de folies. L’argent coulait à flots. Des femmes nues dansaient la cumbia ; tout en les regardant, des nababs allumaient leur cigare avec des billets de banque.
Cette légende et bien d’autres du même style avaient attiré, jusqu’à ce village perdu de la côte nord de Colombie, des essaims d’aventuriers et de prostituées, « des épaves, des femmes seules et des hommes qui attachaient leur mule à un poteau de l’hôtel, avec pour tout bagage une cantine en bois ou un balluchon de linge ».
Pour Doña Tranquilina, la grand-mère, dont la famille était une des plus anciennes du village, « cette bourrasque de visages inconnus, de tentes sur la voie publique, d’hommes se changeant en pleine rue, de femmes assises sur leur malle à l’ombre d’un parapluie, de mules et encore de mules abandonnées, crevant de faim dans la rue de l’hôtel », représentait seulement la racaille, cet amas de déchets que la prospérité de la banane avait déposé sur Aracataca.
La grand-mère régentait la maison. Dans le souvenir de Gabriel, c’est une bâtisse ancienne avec une cour où le parfum du jasmin flambait dans la chaleur de la nuit, avec des pièces sombres, innombrables, où l’on entendait parfois soupirer les morts. Pour Doña Tranquilina, dont la famille était originaire de la Goajira, une péninsule de sables brûlants où n’habitaient que des Indiens, des contrebandiers et des sorciers, il n’y avait pas de frontière bien nette entre les vivants et les morts. Ce petit bout de femme énergique, aux yeux d’un bleu profond, racontait des choses extraordinaires comme s’il s’était agi de petits faits de la vie quotidienne. À mesure qu’en vieillissant elle perdait la vue, la frontière entre vivants et disparus s’effaça : vers la fin de ses jours, elle parlait avec les morts, elle écoutait leurs soupirs et leurs plaintes.
Quand la nuit tombait sur la maison – la nuit des Tropiques, suffocante, chargée des senteurs du nard et du jasmin, bruissante du chant des grillons –, l’aïeule obligeait Gabriel à se tenir immobile sur une chaise, en lui inspirant la peur des morts qui rôdaient alentour : la tante Petra, l’oncle Lazaro, ou encore cette tante Margarita Marquez, morte dans tout l’éclat de sa jeunesse et de sa beauté, dont le souvenir devait brûler dans la mémoire de deux générations de la famille. « La tante Petra est dans sa chambre, disait l’aïeule à l’enfant. Si tu bouges, ça la fera venir. »
(Aujourd’hui, presque cinquante ans après, quand Garcia Marquez se réveille en pleine nuit dans un hôtel de Rome ou de Bangkok, il éprouve à nouveau, ne serait-ce qu’un instant, cette vieille terreur de son enfance : des morts qui bougent tout près, dans le noir.)