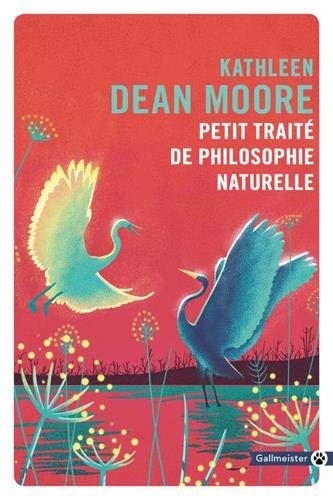Petit traité de philosophie naturelle
Parcourant l'Ouest américain, des côtes sauvages de l'Oregon aux rivages de l'Alaska, ce recueil s'appuie sur l'observation de phénomènes naturels pour nous replacer dans l'immensité du monde, mais aussi, tout simplement, auprès de nos proches. Avec respect, amour et délicatesse, chacun de ces brefs récits est l'occasion de se recentrer sur l'essence même des choses et de saisir la cristallisation de chacune de nos émotions pour mieux nous connaître nous-mêmes.
La presse en parle
C'est un merveilleux livre, petit mais vraiment délicieux. Ses courts chapitres sont des petits bijoux d'écriture, d'intelligence, de sensibilité et d'humanité. [...] C'est absolument magnifique et je les relis régulièrement.
Cristilla Pellé Douël et Ali Rebeihi, Grand bien vous fasse, France Inter
Petit traité de philosophie naturelle, constitué d'une vingtaine de saynètes tirées des souvenirs de l'auteur, fait l'effet d'un bain de grande nature, un milieu sauvage sans commune mesure avec celui que nous connaissons en Europe. Mais cette immersion dans l'Ouest américain est guidée par une main douce et sûre, celle qui tient la plume avec ardeur mais sans grandiloquence. Un enchantement pour les sens et l’esprit.
Astrid de Larminat, Le Figaro Littéraire
Extrait
La leçon du marais
Au bord d’un lac d’altitude désertique, où les eaux de fonte printanières inondent les saules nains et les marécages herbeux, les foulques font un tel tapage que nous avons renoncé à nous parler. Deux mâles, tête baissée, foncent l’un sur l’autre à travers les eaux du lac. Ils se heurtent du poitrail et s’engagent dans un pugilat tout en ruades. Pas facile, apparemment, de ruer sur l’eau quand on est foulque: ça retombe et ça rejaillit, ça se retrouve sur le dos, ça veut retenir l’adversaire d’une patte en le claquant ferme de l’autre... Tout cela fait un bruit épouvantable : vociférant comme des gorilles, les oiseaux battent l’eau de l’aile et de la patte jusqu’à disparaître derrière un rideau d’écume. Les bernaches font comme si ce spectacle ne les concernait pas. Le mâle évolue entre les foulques et ses oisons tel un père de famille qui ferait traverser à ses enfants une rue mal famée. Quant aux carouges à têtes jaunes, ils ne partagent pas cette pudeur. “Waoh !” s’écrient-ils en chœur, “Waoh !”. Frank et moi, assis dans le canoë, observons sans vergogne ce spectacle à travers nos jumelles.
Soudain, le combat cesse. Les oiseaux se tournent le dos et, dans un souverain mépris, lèvent leurs ailes comme un pan de chemise, montrant leur derrière à l’adversaire. Sur leurs arrière-trains de canard, on voit deux gros points blancs. Les plumes en bataille, le front enflé par la colère, ils caquettent sans trêve ni repos si bien qu’on les entend à l’autre bout du lac. S’il est une chose à laquelle tient la foulque, apparemment, c’est bien de continuer toute la nuit sur ce ton.
Le plus souvent, les grèbes sont d’élégants volatiles au long cou blanc et au regard pensif. Mais ce soir, leur cou ploie si loin en arrière que leur front en vient presque à effleurer leur queue, dévoilant une gorge arquée d’un blanc splendide. Au moment même où nous guettons le salto arrière qu’ils semblent préparer pour mieux nous épater, deux grèbes se rejoignent. Ils relèvent la tête, allongent le cou démesurément, se dressent sur l’eau en pagayant, frénétiques. D’un seul élan, ils gagnent ensemble le cœur du lac, portant haut leur cou arqué avec l’orgueil fringant de jeunes étalons. Puis ils ralentissent et s’enfoncent dans l’eau avant de plonger en profondeur. “Waoh !” crient les carouges.
On les compte par milliers, ces têtes-jaunes qui tous penchent et oscillent sur les hautes branches d’un fourré de saules, toutes plumes jaunes dehors, levant l’aile pour faire admirer leurs larges épaules et leur étincelant duvet blanc. Poursuites et parades, épates et menaces, et ce cri d’appel qui semble réclamer le silence malgré leur bec toujours ouvert. C’est un spectacle ininterrompu de grossièretés, d’insultes et d’imprécations, de défis lancés d’une voix rude et rauque, encore et toujours. Au milieu de tout ce désordre, je me sens comme une surveillante en charge d’écoliers déchaînés. Haut dans le ciel, une bécassine dessine une série d’arcs immenses et ses ailes raclent le vent, faisant entendre comme un hennissement.
Toute cette énergie requise par ces scènes de lutte, de sexe, d’invasion territoriale. Sans parler des hirondelles qui descendent en piqué pour happer un insecte à la surface de l’eau, ou se perchent en jacassant sur un fil barbelé tendu au-dessus du marais. Parfois deux d’entre elles filent dans les airs se faire des caresses, puis retombent de concert. En descendant, elles battent légèrement des ailes de façon à dessiner une spirale étroite dans laquelle leurs deux corps se frôlent dans un contact ténu comme un baiser. Cette parade nuptiale est la plus belle que j’ai jamais vue. Nous virons de bord pour observer de nouveau ce doux frôlement, ce plongeon spectaculaire, cette chute frémissante, comme un somptueux ballet. Et voici qu’un autre couple frémit et s’abat, qu’il se frôle à son tour, et, comme le bout de leurs ailes affleure l’eau, les hirondelles s’enfuient dans des directions opposées. À l’autre bout du lac, les collines sereines se réfléchissent dans les eaux battues et troublées par ces oiseaux opiniâtres, tout de bruit et de fureur, concentrés avec ardeur sur leurs activités du moment. Leurs cris emplissent l’air comme une charge électrique.
Vient le tour des grenouilles. C’est d’abord le soprano en dents de scie des rainettes: kre-keck, kre-keck! Les grenouilles aux pattes rouges ont un cri plus grave, un battement régulier à deux temps – GRACK-grick ! – qui monte de la rive proche. Ce lac est un chaos sonore, un orchestre de fous décidé à faire ses vocalises. Toute la nuit se passera en huées et jacasseries, soupirs et couinements. Un grèbe à cou noir surgit brusquement près du canoë. Il nous contemple d’un œil rougeoyant. Une aigrette de plumes dorées jaillit, étincelante, de part et d’autre de son front. Soudain, l’oiseau baisse la tête et lève un peu les ailes, menaçant. Veut-il prendre d’assaut le canoë ? Il nous observe à nouveau, baisse le bec, fait une galipette dans l’eau et s’enfuit. Une douzaine de harles battent l’eau de leurs ailes avant de s’envoler dans la nuit. Le ciel perd ses dernières lueurs jaunes. Enfin, le marais s’apaise.
Tout cet hommage tapageur à la vigueur et à la vie, à l’amour et à la beauté, tant de force et d’attention consacrées au renouvellement des générations... tout cela nous laisse figés, haletants et exaltés. Toute cette vie animale, hilare et rageuse à la fois. Quel en est le sens ?
Il vient toujours un moment où, dans mon cours de philosophie, un étudiant soulève la question, quitte à rougir d’embarras parce qu’elle semble parodier toutes les autres. Quoi qu’il en soit, le voilà qui se lance : Pourquoi tout ceci ? Qu’est-ce que cela signifie ? Quel est le sens de la vie ?
Le plus souvent, la question se laisse facilement éluder. L’enseignant joue les beaux parleurs, botte en touche, et comme la philosophie, de nos jours, est surtout affaire de langage, il lui suffit de retourner la question à l’envoyeur, ou de lui répondre que, si elle lui vient à l’esprit, sans aucun doute la réponse ne le satisfera-t-elle pas. Et les mots finissent par manquer, et les étudiants s’agitent sur leur chaise, impatients de revenir aux questions susceptibles de tomber à l’examen.
Mais voilà : la semaine dernière, une étudiante qui avait travaillé la métaphysique et l’épistémologie, et Søren Kierkegaard, une étudiante qui lisait Kant et apportait des fruits frais en classe, s’est tuée chez elle d’un simple coup de fusil en pleine tête, assise à sa table de cuisine. Elle n’a laissé aucune note, aucune explication, et personne n’y comprend rien. Ses professeurs s’affaissent contre les murs de la classe sans pouvoir prononcer un mot. Nous comprenons, trop tard, que nous n’avons jamais appris à nos étudiants ce que les canards savent sans savoir. Que, comme le disait Dostoïevski, “il nous faut aimer la vie plutôt que le sens de la vie”. Il nous faut aimer la vie par-dessus tout, et de cet amour naîtra peut-être un sens. Mais “si cet amour de la vie disparaît, rien ne peut nous consoler”.
Que nous disent-ils, ces instants semblables à un prisme braqué sur l’existence, que disent ce marais, cette humidité, ce vacarme écumant, cet assaut de volonté parmi les saules, cette scène criarde, ces couleurs, ces plumages, ces efforts, ce bruit, cette complexité, tout ce qui ne laisse ni note ni explication ?
Rien, me semble-t-il, si ce n’est qu’il faut continuer.
C’est la leçon du marais. La vie concentre toutes ses puissances sur un seul but : continuer à exister. Un marais au crépuscule, c’est la vie qui exprime son amour de la vie. Rien de plus. Mais rien de moins, et nous serions stupides de nous dire que c’est là une leçon sans importance.