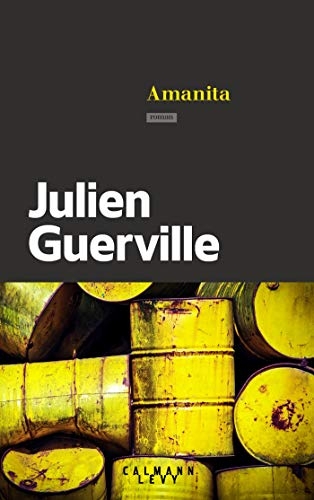Amanita
"L’air empestait le plastique. Avec le temps, j’avais cru que j’oublierais. Que je m’y habituerais. Mais ça ne passait pas. L’odeur acide et piquante des polymères s’insinuait partout. Toujours."
Calvin travaille de nuit à l’usine pétrochimique de Poghorn. Le jour, il traîne au bordel, parcourt les montagnes avec son chien et fabrique des pilules hallucinogènes à base d’amanites tue-mouches. La vie. La routine. Jusqu’à ce que la femme de son frère, Kimiyo frappe à sa porte, le nez fendu et l’arcade cassée ; jusqu’à ce que les télés annoncent la fermeture de l’usine.
Un roman noir, social, terriblement actuel, porté par une plume aussi incisive que poétique
Extrait
Chimie
Je me suis levé relativement tôt. Le goût du plastique toujours tapissé dans le fond de la gorge. Acide. Synthétique. Polychlorure de vinyle et chlorure d’hydrogène. Par la fenêtre, le soleil clignotait doucement entre les feuilles de frêne et d’aulne, scintillait dans le salon en une kyrielle de taches mouvantes – jaunes, vertes et rouges. Je me suis raclé la gorge. J’ai craché un truc marron dans l’évier et j’ai allumé une cigarette. Au bout d’un moment, la nicotine finissait par masquer les parfums de PVC qui me rongeaient les racines de la langue. J’ai fait couler du café. Je l’ai regardé passer en soufflant de petits nuages bleus. L’odeur du plastique se confondait avec celle du tabac. Encore.
Je suis sorti. Sur la terrasse, les planches étaient encore fraîches. L’air humide du matin se réchauffait doucement et des colonnes de vapeur s’élevaient au-dessus du pré. Je buvais par petites gorgées – arabica et Golden Virginia. Le bois de la rambarde a grincé lorsque je me suis appuyé dessus. Au bout du terrain, l’eau de la Bez filait entre les fougères et les arbres, régulière et hypnotique comme une descente d’arpège dans un morceau d’Oyha. Je tenais mon café à deux mains. L’air était encore frais. La chaîne de Job a tinté au sous-sol entre les pilotis de châtaignier. Et à peine avais-je descendu les quelques marches qui mènent au pré qu’il s’est mis à aboyer. Il tirait sur sa laisse et essayait de me sauter dessus. Je lui ai donné quelques tapes sur le flanc. J’ai tiré un peu sur ses oreilles en esquivant ses pattes boueuses, avant de lui servir une poignée de croquettes. « Salut mon gros. »
Au-dessus de nos têtes, le ciel était rose, gris et par endroits un petit peu bleu.
— Régale-toi, j’ai fait, en l’écoutant grogner de bonheur.
Sur la platine, Joanna Newsom jouait Emily.
Sa voix enfantine emplissait la baraque. Mélancolique et belle. J’ai passé mon mégot sous le robinet. La harpe résonnait contre les poutres. Je suis allé prendre une douche.
Dans le miroir : les cernes, la fatigue. Des cheveux filasse qui tombent sur mes épaules. Des poches sous les yeux et le reflet de mes joues creuses. De mes yeux gris. J’ai fait quelques grimaces pour donner le change et je me suis glissé sous l’eau. La chaleur et la vapeur ravivaient l’odeur du plastique, toujours.
« And the stirring of wind chimes / In the morning / In the morning. »
Dehors, des rayons de lumière dorée réchauffaient l’atmosphère.
J’ai laissé la porte ouverte.
J’ai détaché le chien.
Les fougères à demi mortes envahissaient le sentier, semblables aux antennes d’insectes géants. Les châtaignes tombaient du ciel comme autant de petites météorites pointues. J’avais décidé de monter directement sur la crête et de redescendre par le mobil-home pour contrôler l’hydrométrie et vérifier que tout se déroulait correctement. Avec ce temps qui changeait sans arrêt, il fallait que je me tienne sur mes gardes si je ne voulais pas tout foirer. Job galopait. Il reniflait les troncs, il fouillait dans les feuilles. Il respirait chaque touffe d’herbe à la recherche des mycéliums d’Amanita muscaria. Les tue-mouches. Les rouges avec les points blancs. Avec le temps, il avait appris à trouver les filons, alors j’essayais de ne pas le perdre de vue, de ne pas le couper dans son élan et de suivre son rythme. Je donnais un itinéraire global, et je me laissais guider.
On a longé la Bez jusqu’aux confins de la vallée. Le parfum des polymères en fusion rôdait dans les sous-bois et camouflait parfois celui de l’humus en décomposition. Les derniers odonates de l’année zigzaguaient entre les branches tombantes et les rameaux de lierre. Et de temps en temps, du bout du pied, je remuais les feuilles sans trop y croire.
Job a trouvé une piste à l’entrée du sentier qui mène au sommet du Fageas. Trente minutes de marche, au bas mot, et dans une pente qui vous scie littéralement les jambes. Job aboyait et courait en se faufilant sous les bruyères et les ronces. J’avais un mal fou à le garder en vue. Et lorsqu’il m’attendait au détour d’un arbre, il se roulait par terre et se campait sur ses pattes arrière – fou à lier et la langue pendante. Et puis, il s’est mis à monter tout droit à travers la forêt, de plus en plus vite. Je l’entendais fouiner et grogner. Les feuilles et les châtaignes grinçaient sous mes pieds. Les bogues dégringolaient en rebondissant sur les ruines des anciennes terrasses de pierre sèche. Mon cœur cognait et résonnait contre mes os. À partir de là, la piste devenait à peine un vague sentier, à peine un passage de sanglier. La végétation se préparait à l’hiver, mourait un peu partout.
J’ai gueulé d’une voix éraillée pour qu’il mette le holà. Je m’étranglais à moitié, le tee-shirt collé contre les reins.
J’ai fait une pause en essayant de reprendre mon souffle. Les mains sur les genoux. Les mains sur les hanches. Les mains appuyées derrière la tête. Autour de moi, des rayons verts filtraient entre les troncs et les feuilles. Il me restait dans les deux cents mètres avant de retrouver le chemin de crête. J’ai récupéré doucement en écoutant les geais brailler ; le bruit des feuilles de châtaignier mortes sous les pattes de Job s’est éloigné pour ne devenir qu’une vague rumeur persistant contre mes tympans.
Au bout d’un petit moment, j’ai pu reprendre l’ascension, et au sommet, j’ai allumé une cigarette en grommelant « connerie de clébard ». J’ai fermé les yeux ; le vent me faisait du bien. Mes cheveux étaient collés contre mon front. J’ai replacé une mèche sous l’élastique, la clope coincée entre les dents.
Sur la crête, la chaleur du soleil comme une réponse ; un pendant mystique aux courants d’air sifflants et froids qui filaient d’un versant à l’autre. J’ai suivi la route forestière vers le sud-ouest en profitant de la vue sur les trois vallées du Galhid. Des masses de brume remontaient le long de la montagne et passaient les cols pour disparaître dans un immense ciel bleu. J’ai rejoint un dolmen au bout duquel une dalle de schiste surplombait le vide. Je me suis avancé sur le promontoire. D’ici, on dominait la plaine du Rauc et on voyait jusqu’à la mer : à l’est, perdues sur l’horizon, les orangeraies de l’AOOR, le désert jaune et ocre. Les serres des producteurs de tomates qui scintillent dans le soleil aux abords de Grand C. La Bez prenait la direction du sud à cet endroit-là, grosse des torrents de montagne, elle étendait son delta à travers le Rauc comme les pattes d’un oiseau. En face, Grand C. et les aiguilles des Grives. Au-delà, la mer et le ballet des porte-conteneurs. À l’ouest, plus loin, on devinait le halo gris de Poghorn qui glisse et se cogne contre les falaises, qui tourbillonne doucement. Et au pied du Fageas, les vapeurs moites et cuivrées qui s’échappent des cheminées de la ProSol.
J’ai mis mes mains en porte-voix pour appeler Job. Putain de clebs. J’ai sifflé deux ou trois fois. Les nuages s’étiraient et s’effilochaient en basculant de l’autre côté du col. J’ai tendu l’oreille sans bouger. Quelque chose fouillait et froissait les feuilles quelques mètres plus bas. Sous la ligne de crête, un passage entre les pierres éboulées, les fougères et les bois morts. Une ouverture qui redescendait à pic, vers la plaine et plein sud. Je l’ai empruntée et j’ai retrouvé le chien en train de pisser contre la carcasse d’une voiture à demi brûlée. La carlingue encastrée entre deux chênes. De petites feuilles lancéolées recouvraient le pare-brise. D’autres, jaunes et marron, tombaient sur le métal noir. Je me suis approché de l’épave en me tenant aux branches et aux racines. Le Fageas servait souvent de décharge sauvage. C’était assez loin de Poghorn tout en restant à une distance raisonnable. Et les types qui voulaient arnaquer des assurances ou éviter de payer une fortune à la casse de Ben Cort venaient balancer leur bagnole du haut de la piste forestière – la barrière s’ouvrait avec une clef de 14. La tôle a grincé contre une branche lorsque j’ai actionné la portière. Le pare-brise était intact. La voix dans ma tête a murmuré. L’habitacle sentait l’essence calcinée et l’eucalyptus. Un petit sapin de cellulose pendant au rétro. J’ai fouillé la boîte à gants et les vide-poches ; j’ai passé ma main sous les sièges. J’ai trouvé des capsules de bière, un paquet de chips, des mégots, quelques pièces de un et de deux, un paquet de cigarettes à moitié vide et une carte de fidélité pour un food-truck de Poghorn – dressée au nom de Yevgeni Palenko. J’ai passé en revue le reste de l’auto : quelque chose poissait contre le volant. C’était sec et marron avec des écailles aux reflets bordeaux. Des poils rêches et bruns garnissaient le siège passager et la banquette arrière. Un courant électrique s’est faufilé le long de mon nerf sciatique. Un frisson.