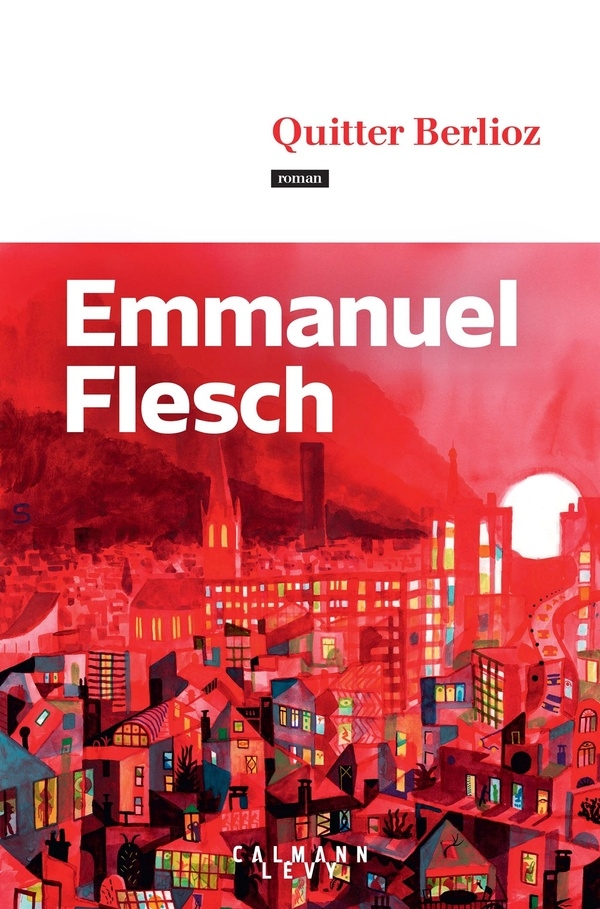Quitter Berlioz
« Son visage possédait une beauté revêche, vaguement bohémienne, qui évoquait des barres de cité, des familles nombreuses et des halls enfumés, un mélange de ruse et de fatalité. »
Younes veut croire en sa dernière chance. À vingt-trois ans, il sort de prison. Sa libération anticipée est assortie d’un placement sous surveillance électronique : chaque soir, après le travail, il devra rentrer à Berlioz, la cité de son enfance.
Il reprend aussitôt du service comme coursier-moto chez Panam’Expres, où il s’apprête à revoir Serge, son meilleur ami.
Ils ont grandi sur la même dalle de béton. Ont fait ensemble les quatre cents coups. Et, malgré le fossé qui se creusait entre les communautés, ils sont restés fidèles l’un à l’autre.
Retrouvant tour à tour ses camarades de course, la frénésie parisienne, les périls du dernier kilomètre, Younes s’accroche à cette drôle de liberté, suspendue au joug de son bracelet électronique. Jusqu’au jour où l’amour frappe à sa porte.
Avec Quitter Berlioz, Emmanuel Flesch tisse une intrigue sociale haletante dans la France black-blanc-beur des années quatre-vingt-dix. Un roman grave et lumineux.
Une ode à l’amitié
La presse en parle
Emmanuel Flesch nous propose un roman social assez sombre situé dans un univers jamais traité en littérature. "À l'origine de mon livre, il y a l'envie de raconter une histoire d'amitié entre deux garçons qui les accompagne jusqu'à l'âge adulte et l'envie de placer au cœur d'un dispositif romanesque des personnages de la périphérie littéraire, en l'occurrence des coursiers. Je voulais immerger le lecteur dans le quotidien de ces jeunes hommes qui travaillent à la frontière de la domesticité et du salariat", explique l'auteur.
L'amitié dont nous parle Emmanuel Flesch est celle de Serge et de Younes. Ils sont unis à la vie et à la mort. Ils ont grandi tous les deux dans les années 80 sur la même dalle dans la cité Berlioz. Tous les deux ont des parents ouvriers qui ont travaillé dans la même usine. Et puis le premier prend des mandales au premier faux pas et le second, qui est un élève brillant, va petit à petit déraper dans la petite délinquance. On les découvre enfants, on les retrouve adultes. Ils sont tous les deux coursiers dans la même boîte. Younes sort de prison quand s'ouvre cet ouvrage. Il a l'obligation de rentrer chez sa mère le soir à 20h, sinon c'est retour en prison. Entre deux courses folles, il a des dettes à rembourser, des comptes à régler et le cœur de sa bien-aimée à reconquérir. Elle s'appelle Vanessa et elle est hôtesse d'accueil de son état.
France Info
Extrait
Cet été-là, un cyclone s’était échappé du cœur tropical de l’Atlantique. Il se propulsait plein est, déréglant sur son passage les circulations atmosphériques. De lourdes masses d’air se précipitèrent sur les îles Canaries. L’océan se déchaînait. Un chalutier irlandais disparut dans la tourmente, au large du Maroc. Bientôt, la houle submergea la muraille d’Agadir, inondant les ruelles de la médina. Les vitres ruisselaient d’écume. Plus loin, le vent sifflait entre les taules du bidonville. Les enfants pleuraient. Des morceaux de toit s’envolèrent, emportés à travers l’immensité torride du Sahara, où la tempête, contrariée par les hautes pressions, brûlée par le sable, obliquant vers le nord, écrasa sous une vague de chaleur les îles de la Méditerranée, le golfe du Lion, le Languedoc, la vallée du Rhône. Finalement, la France tout entière.
À Paris, le ciel se brouilla. Les carrosseries s’effaçaient sous une pellicule de sable rose, le thermomètre s’affolait. La ville se mit à suffoquer sous le tamis du sirocco. La nuit, on se retournait dans des draps trempés de sueur. Les journées se consumaient en heures de feu, plates, immobiles, sans contours. D’un trottoir à l’autre, les chiens se traînaient gueule ouverte, en quête d’un peu d’ombre. La canicule s’infiltrait jusque dans les caves. Insensiblement, le fond de l’air se chargea d’une odeur de bitume recuit. Sur le seuil des cabines téléphoniques, on pouvait apercevoir des silhouettes harassées, suffocantes, tirant en pure perte sur le fil du combiné.
L’épisode fut bref. Vidé de ses forces, le cyclone acheva sa course dans les eaux tièdes du golfe de Gascogne et, l’horlogerie climatique retrouvant son cours habituel, l’été s’acheva dans les orages. On ne savait plus comment s’habiller. Sans transition, les feuilles des platanes commencèrent à pâlir. La courbe des jours fléchissait à vue d’œil, l’automne n’était pas loin.
Un automne froid, baigné d’un bout à l’autre d’une lumière chiche et plaintive. De gros nuages atlantiques, gorgés d’océan, roulaient sans cesse au-dessus du Bassin parisien, crevant tantôt sur les Yvelines, tantôt au-delà de la Seine-et-Marne. Les parapluies se heurtaient sur les trottoirs. Les scooters soulevaient dans leur sillage des geysers d’eau sale. Sous les porches, à l’entrée des parkings, des coursiers ruisselants grillaient une cigarette en quatrième vitesse, avant de ramasser leur tournée, la mine butée. Parfois, le plafond des nuages se déchirait, cédant la place à une brève éclaircie. Un soleil oblique épuisait quelques rayons à la surface de la Seine et Paris devenait une huile de Monnet. Les touristes sortaient leur appareil photo. On se mettait en tête de prendre en terrasse un dernier café, le visage crispé, le col relevé jusqu’aux oreilles, retenant les pages d’un journal froissé par le vent. Et puis le soir venait, et tout se noyait dans le gris des murs.
S’ensuivit un long hiver sans neige. Janvier se traîna sous un ciel de taule. Février ne fut guère plus indulgent. La pression atmosphérique remontait à pas comptés lorsque l’anticyclone tant attendu s’exila sans prévenir en Arctique, précipitant une coulée froide sur l’Europe. Le dernier lundi du mois, une tempête de neige balaya le Finistère, engloutit les collines du Perche, s’engouffra dans la plaine de la Beauce. Elle s’abattit sur Paris en fin d’après-midi. On n’avait rien vu venir. Sur la visière de son casque, Serge Bailleul essuya les premiers flocons porte de Champerret. Il était en route pour ramasser un pli à Levallois, en poser un autre à Puteaux, incapable d’imaginer qu’il abandonnerait sa Vespa deux heures plus tard, à Pantin, dans dix centimètres de poudreuse.
À vrai dire, personne n’était en mesure de se figurer le chaos d’embouteillages, de klaxons éperdus et de voitures délaissées, sur lequel se refermerait la nuit. Trois cent cinquante kilomètres de bouchons. L’Île-de-France pétrifiée sous la neige.
Vers dix-neuf heures, on apercevait encore, ici ou là, à travers la purée de pois, le slalom maladroit d’un livreur de pizza. Le périphérique, les autoroutes, l’entrelacs des axes secondaires, plus rien ne bougea bientôt sous la tempête que le balai des essuie-glaces. Trois cent mille banlieusards s’apprêtaient à passer la soirée dans l’habitacle de leur véhicule. Les moins chanceux ne rentreraient pas chez eux avant le point du jour, cela commençait à devenir une évidence, au moment où Serge Bailleul reçut enfin l’autorisation de débaucher, quand bien même il n’avait pas fini sa tournée.
Il s’engagea sur le périphérique intérieur. Les voitures se blottissaient les unes derrière les autres, pare-chocs contre pare-chocs. Serge Bailleul roulait en seconde, les pieds raclant la neige, entre les nuages des pots d’échappement. La lumière des phares éclatait en millions d’étoiles à travers les flocons. Il ne voyait plus rien. Il tremblait de froid. La chaussée était plus glissante qu’une flaque d’huile et il n’avait pas encore dépassé la porte de la Chapelle. Sous son casque, il roulait des yeux de gibier traqué, jalousant tous ces profils d’automobilistes, aperçus de trois quarts, le temps d’un éclair. Chauffage, essuie-glaces, allume-cigare, autoradio, tous les bienfaits de la civilisation lui semblaient pouvoir tenir dans une voiture.
Une demi-heure plus tard, il tira la béquille de sa Vespa. Épuisé par une journée de route longue comme un fleuve russe, il avait réussi à rejoindre les confins de Pantin, en bas de la côte de Romainville. C’était le bout de la route. Plus loin, sa roue arrière risquait de chasser dans la pente. Il couvrirait à pied le dernier kilomètre. Le vent avait faibli, les flocons dansaient paresseusement dans le halot des réverbères.
Serge Bailleul coupa le contact et tira le tablier sur la selle, avant de récupérer dans sa caisse deux plis en souffrance