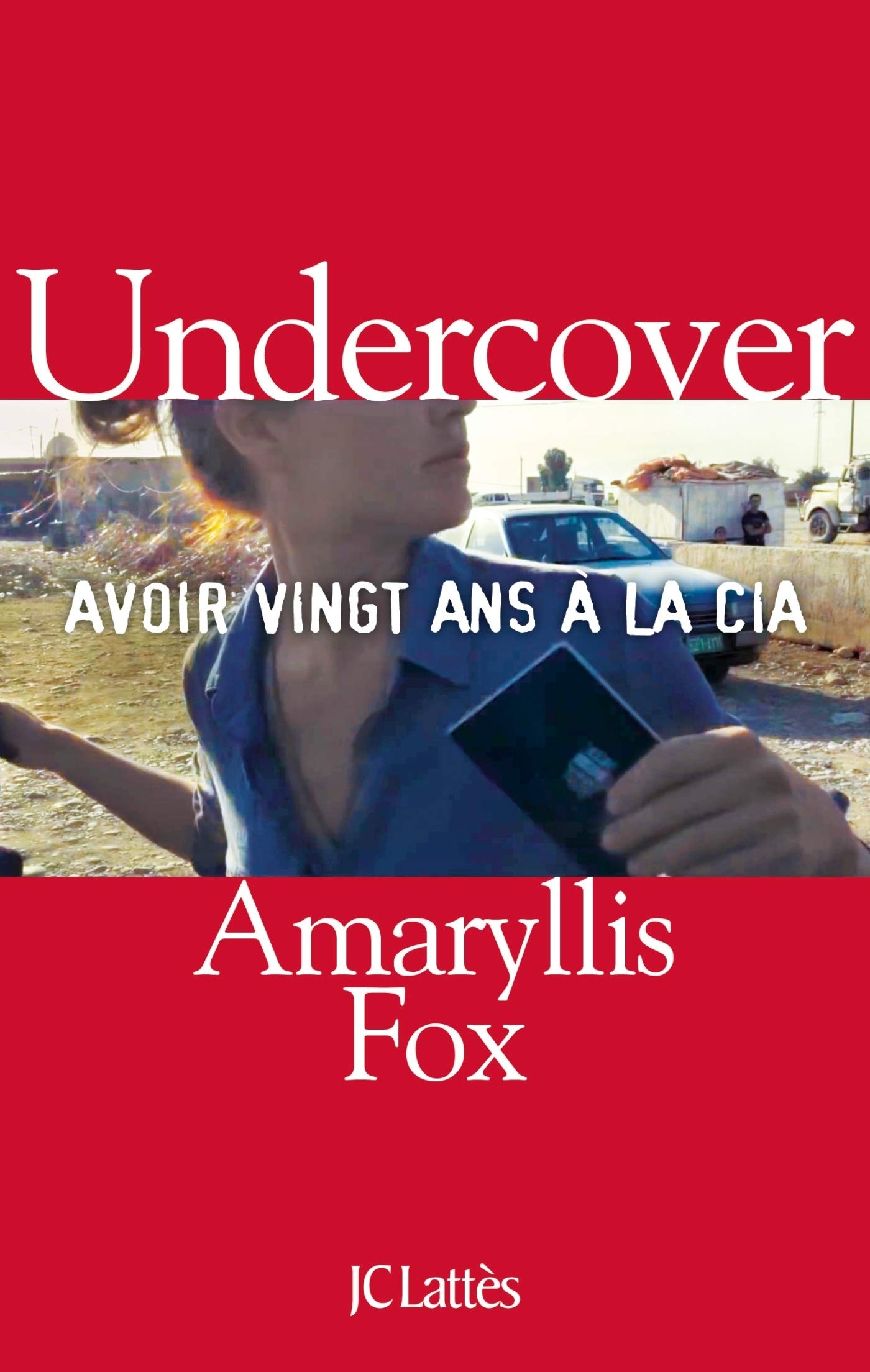Undercover: Avoir vingt ans à la CIA
À vingt et un ans, Amaryllis Fox est recrutée par la CIA. Sa première mission est d’analyser des centaines de communications top-secrètes transmises par des sources du monde entier, et de les synthétiser pour le rapport journalier que fournit l’Agence au Président des États-Unis. Elle est ensuite affectée au centre antiterroriste dédié à l’Irak. À vingt-deux ans, elle intègre, plus tôt que l’âge minimum requis, le célèbre centre d’entraînement des officiers opérationnels de la CIA, « la Ferme », où pendant six mois elle va apprendre à se servir d’un pistolet Glock, à se débarrasser de ses menottes quand elle est enfermée dans un coffre de voiture, à résister à la torture et découvrir les meilleurs moyens de mettre fin à ses jours au cas où elle se retrouverait prisonnière. À la fin de cette formation intensive, elle est envoyée sur le terrain comme agent opérationnel clandestin. En se faisant passer pour une marchande d’art ethnique, elle va infiltrer des réseaux terroristes au fin fond du Moyen-Orient et en Asie.
Undercover retrace le parcours hors-norme d’Amaryllis Fox où se mêlent à parts égales courage héroïsme et une compassion infinie pour le genre humain… Captivant, jubilatoire, intime et brillant.
La presse en parle
Même s'il comprend sa dose de scènes à haute tension, la force du récit est de s'attarder sur les implications humaines et intimes du métier d'espion.
Elle
Extrait
Dans la vitre, j’observe l’homme qui me suit. Je l’ai repéré quelques rues plus haut parce que son chemin croise curieusement le mien dans le dédale de Karachi. Nos reflets se mêlent dans la vitrine du tailleur. Un grand type, avec un visage allongé, comme la tête d’un cheval. Quand il marche, ses mains le long de son corps s’ouvrent et se ferment alternativement. « La sécurité du voile », scande une affiche dans la boutique, au-dessus d’un assortiment de burqas et de hijabs.
Le bus que je compte prendre passe devant moi dans une débauche psychédélique de couleurs. Chaque centimètre carré est couvert d’arabesques et autres motifs décoratifs, tel un char de carnaval, un temple dédié au dieu diesel pour le plaisir des yeux. On dirait un grand animal de bât en liberté, un dragon cheminant lentement dans la ville, engoncé dans sa cuirasse majestueuse, emportant des grappes de voyageurs accrochés à ses flancs ou juchés sur son dos. J’adore ces bus pakistanais. Je ne m’en lasse pas. Quand ils apparaissent, au milieu de la poussière, des fumées et des klaxons, c’est toujours une surprise, comme si je distinguais alors le brin de folie sous l’apparence austère d’un inconnu.
Attendre le prochain bus pour la Mohammed Ali Jinnah Road ne me retardera pas beaucoup. Il y en aura un autre dans quelques minutes. M. Tête-de-cheval ne doit pas se dire que j’essaie de le semer. Rien ne paraît plus suspect que de tenter d’échapper à la surveillance de quelqu’un. Cela me fait toujours rire quand je vois au cinéma des scènes avec des agents de la CIA – ces poursuites acrobatiques sur les toits des immeubles, ces duels acharnés à coups de Glock. Dans la vie réelle, une seule escarmouche dans un centre-ville et ma couverture est grillée à vie ! Mieux vaut leur faire croire qu’ils n’ont pas été repérés, endormir leur vigilance. Marcher tranquillement pour rester en vue. En voiture, s’arrêter aux feux orange. Demeurer bien en évidence quand on change de rue ou que l’on pénètre dans un bâtiment. En d’autres termes, il faut qu’ils s’ennuient à mourir. Et alors seulement on disparaît. Le principe : jouer les James Bond uniquement lorsque leurs sens sont endormis.
En reflet, je vois M. Tête-de-cheval tripoter des ustensiles de cuisine sur l’étal d’un vendeur en attendant que je bouge. Je ne sais pas trop dans quel camp il est. Première hypothèse, la plus évidente : c’est un agent du contre-espionnage local. Mais cela paraît peu probable. Les services de renseignement pakistanais sont plutôt bons. Quand ils filent quelqu’un, ils envoient une équipe de six ou sept personnes, pour pouvoir changer de pisteurs afin de réduire les risques de se faire repérer. Or cet homme est visiblement seul. En outre, il n’a pas l’air d’être un natif. Malgré sa tenue traditionnelle, le long kameez qui recouvre son pantalon, il semble plutôt originaire d’Asie centrale. Un Kazakh ou un Ouzbek. Sans doute me surveille-t-il en prévision de la rencontre de demain. Al-Qaida a eu, dernièrement, de nouvelles recrues en provenance d’Asie. Employer les bleus comme fileurs est un classique. Ça leur permet de se familiariser avec la ville pendant que les cadres évaluent leurs compétences.
Je le regarde se faufiler entre les étalages qui bordent le bazar Jodia. Il tripote des pièces de carburateur, fait mine de les examiner. À le voir faire, je me demande s’il n’appartient pas à la troisième catégorie : un aspirant trafiquant d’armes qui sait que je travaille avec Jakab, le Hongrois qui a accès à tout le surplus militaire soviétique. Bien sûr, reste la quatrième possibilité : qu’il s’agisse juste d’un prédateur sexuel qui vient de repérer une Américaine de vingt-huit ans se promenant seule dans les rues. Après tout, il y a toujours le principe du rasoir d’Ockham : l’explication la plus simple est souvent la bonne.
Espion des services secrets pakistanais ou trafiquant en herbe, peu importe. Quand on est grillé, il faut annuler la mission. À quoi bon rencontrer son contact ou récupérer des documents si l’on est observé. Même le pékin le plus inoffensif peut se révéler dangereux s’il pense être témoin d’un événement digne d’intérêt. Par chance, je ne suis pas en opération. Ce sera pour demain. Aujourd’hui, c’est juste de la reconnaissance.
Jakab m’a dit « au carrefour de Abdullah Haroon et Sarwar Shadeed ». C’est tout ce qu’il sait. Et déjà, il n’était pas censé être au courant. Il a tiré les vers du nez de ses acheteurs, prétextant qu’il cherchait à leur vendre la meilleure bombe pour leur projet. S’il connaissait la nature de leur cible, il pourrait déterminer la quantité nécessaire de matériau fissile pour affoler les compteurs Geiger. Parce que c’est ça leur véritable but : attirer l’attention.
Quand le bus suivant arrive, je monte tranquillement à bord. Comment soupçonner que je m’apprête à visiter la cible d’un prochain attentat terroriste cette fois avec une charge nucléaire. Tête-de-cheval grimpe sur le toit, tandis que je m’installe dans le compartiment réservé aux femmes. Dehors, l’après-midi tire à sa fin et les deux roues ont déjà allumé leurs phares. C’est la meilleure heure, malgré les embouteillages, pour admirer la ville. La plupart des bâtiments sont plus anciens que le pays lui-même ; des monuments datant d’une époque où l’Inde et le Pakistan étaient un seul et même pays, le jouet du Raj, l’empire colonial anglais. Cela réveille mon vieux patriotisme yankee – quand mes ancêtres avaient mis fin au joug britannique. J’imagine ces hommes et ces femmes qui m’entourent jetant des caisses de thé dans l’océan avec leurs kameezes et leurs châles multicolores. Nous sommes un pays rebelle, eux comme nous. Si seulement nos révoltes n’avaient pas fait couler tant de sang.
J’aperçois le carrefour au bout du flot de voitures et de charrettes, au-delà des toiles tendues entre les bâtiments pour faire de l’ombre. Sur un côté se dresse la banque nationale du Pakistan, qui pourrait être un objectif de choix. Après tout, les mollahs ont bien validé les tours du Word Trade Center comme cible militaire, puisque selon eux les Américains tuent autant de musulmans avec leur économie, en paupérisant des innocents, qu’avec les chenilles de leurs chars. Mais je n’y crois pas. La banque est un cube de béton disgracieux, une pure horreur datant d’après-guerre, quand il fallait reconstruire au plus vite. Ce bâtiment peut difficilement passer pour un symbole de l’outrance décadente de l’Occident.
J’attends que le chauffeur ralentisse pour sauter du marchepied et retrouver la poussière de la ville. Tête-de-cheval descend par l’arrière du bus. Je traverse tranquillement la rue Abdullah Haroon, pour lui laisser le temps de me suivre, et quand j’atteins le trottoir de l’autre côté, la lumière se fait dans mon esprit. Légèrement en retrait des grilles cadenassées, j’ai devant moi un château miniature, une forteresse de pierre lilliputienne plantée au milieu des nuées de rickshaws et de pigeons : le Club de la presse de Karachi, le bastion de la libre parole et du journalisme indépendant, le haut lieu de la protestation et des débats, et le seul endroit du pays où le bar sert de l’alcool. Voilà leur cible ! J’en mets ma main à couper. Quoi de mieux que de frapper au cœur du péché. Le slogan est tout trouvé : une bombe pour les infidèles qui « font la bombe ».
À en croire Jakab, cet attentat doit être un avertissement. Effectivement, ce sera un coup de semonce pour tous les pays où la presse est aussi libre que la consommation d’alcool. Le message sera clair : d’abord on fait le ménage chez nous au Pakistan, puis ce sera le tour des mécréants d’ailleurs. C’est une posture élégante, mais à la vérité il est plus facile de mener une attaque ici plutôt qu’à Times Square. Al-Qaida cherche à se procurer l’arme atomique depuis 1992, quand Ben Laden a envoyé ses premiers émissaires en Tchétchénie à la recherche de matériaux fissiles qui auraient pu être oubliés par les Soviétiques au moment de l’effondrement de l’URSS. Mais les têtes nucléaires perdues sont rares et chères, des divas imprévisibles. Rien d’étonnant à ce qu’ils tentent un coup d’essai à deux pas de chez eux.
Cela signifie que je dois penser à deux théâtres d’opérations en même temps : d’abord, une attaque possible ici, à quelques mètres de moi, et puis une autre, conséquence de la première, sur le sol américain. Experts et intellectuels des quatre coins du globe viennent faire des conférences au Club de la presse de Karachi, y compris nombre de personnalités américaines. Une bombe nucléaire de dix kilotonnes vaporiserait tous les bâtiments et les gens à un kilomètre à la ronde. Si la même bombe explosait dans le siège du New York Times à Manhattan, l’engin réduirait en cendres Times Square, Penn Station, Bryant Park, et la bibliothèque de New York, sans compter les immeubles d’habitation, les bars, les écoles, les taxis, dans une boule de feu plus brûlante que le soleil. Et comme la lumière voyage plus vite que le son, les cinq cent mille victimes du premier cercle seraient pyrolysées avant même d’entendre le moindre boum. Pour le kilomètre suivant, la population, à cause des radiations, mourrait dans les jours suivants. Ensuite, les cancers feraient des ravages dans les quartiers les plus éloignés pendant des années.
Le terrorisme est un jeu psychologique fondé sur l’aggravation du danger. Ce n’est pas la dernière attaque qui fait peur aux gens. Mais la prochaine.
Les attentats contre nos ambassades, comme celle du Kenya ou de Tanzanie en 1998, étaient effrayants. Mais deux ans plus tard, c’est l’un de nos navires de guerre, le USS Cole qui est attaqué dans le golfe d’Aden ! Une cible militaire. On ne peut pas faire plus inquiétant, non ? Et quelques mois plus tard, c’est une tuerie de masse, sur notre propre sol, une apocalypse qui s’abat sur deux tours par une belle matinée ensoleillée.
La problématique pour Al-Qaida après le 11 Septembre est la suivante : comment monter le niveau de menace encore d’un cran ? Qu’est-ce qui pourrait frapper plus l’imaginaire que deux avions de ligne percutant des gratte-ciel ? Quelle opération pourrait faire plus que trois mille morts en un seul mardi matin ? Finalement, le coup suivant ne peut être qu’un grand nuage en forme de champignon. Une explosion si puissante, si aveuglante, que les rares à pouvoir raconter ce qu’ils auront vu en demeureront hantés jusqu’à la fin de leurs jours.
Tête-de-cheval regarde une jeune femme franchir les grilles du Club de la presse. Elle a la tête couverte d’un foulard à motifs imprimés comme un carré Pucci des années 1970. Le bas de son kameez est décoré de fleurs. L’ensemble est discret, et islamique bon ton, avec une infime touche d’originalité comme dans la série Partridge Family. À côté des portes, un homme vend des bouquets de fleurs. Il harangue les voitures, vantant ses prix qui défient toute concurrence. Derrière lui, une enseigne s’agite sous le vent, annonçant l’échoppe d’un dentiste pour enfant.
Je sens mon sang tourner en glace. L’éviscération des corps. Le gâchis. La destruction inutile de ces vies, de ces esprits. J’ai envie de faire volte-face, de foncer sur Tête-de-cheval, de le secouer et lui demander comment il peut oser tuer une femme qui coud des fleurs au bas de ses vêtements ? Comment il peut vouloir tuer cinq cent mille autres êtres humains comme elle. Mais il n’est qu’une petite main, de la piétaille. J’aurais ma chance demain. Une occasion de dire à Al-Qaida pourquoi ce n’est pas une bonne idée de faire exploser une bombe atomique au cœur d’une grande ville. Une seule chance, un face-à-face avec le groupe qui veut mettre ce pays à genoux.
Autant oublier cette ombre qui me suit.
C’est alors que Tête-de-cheval sort son téléphone et me regarde fixement au moment de composer un numéro.