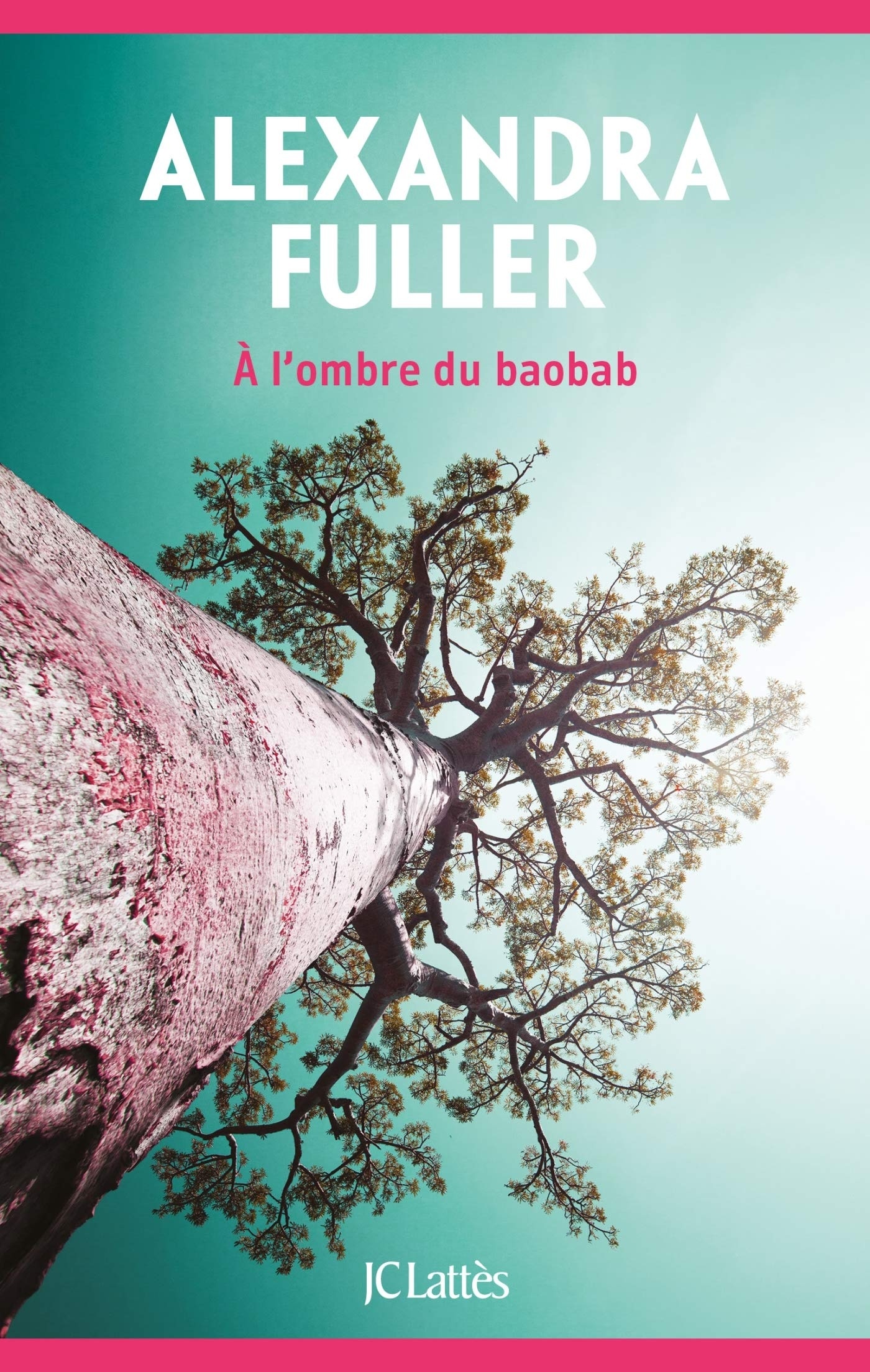A l'ombre du baobab
C’était dans la petite ferme piscicole et bananière d’une chaude vallée qu’ils s'étaient enfin fixés, après des décennies d'errance en Afrique australe et centrale, séduits par la forêt de mopanes, les étangs à poissons dominés par les baobabs à l'écorce rose-argent, et le large fleuve Zambèze coulant paresseusement vers le sud.
Ainsi vivait Tim Fuller, un mouton noir anglais qui s'est exilé en Afrique où il s’est battu lors de la guerre du Bush rhodésienne avant de s'établir en Zambie avec sa famille. Maintenant qu’il n'est plus, l’autrice et sa mère dispersent ses cendres au pied des baobabs qui règnent sur leur propriété et affrontent son absence écrasante. Le résultat est un récit débordant de joie, de vitalité et de résilience dans lequel Alexandra Fuller intériorise les leçons de son père et célèbre la mémoire d'un homme qui dévorait la vie à pleines dents.
Extrait
Dans le cas peu probable d’une rentrée d’argent,
acheter deux billets pour Paris
« Oh, salut, Bobo », dit papa, s’éveillant d’un coma artificiel pour me trouver à son chevet. Il s’efforça de voir où il était. « Arrêt de bus ? demanda-t-il.
— Budapest, répondis-je.
— Ah ? » s’exclama-t-il, déplaçant les fils et les tuyaux qui menaient à sa bouche, à son nez et aux aiguilles qui disparaissaient sous la peau, là où le soleil zambien avait brûlé une ligne brune indélébile en travers de son cou. Les veines saillantes de ses mains épaisses et musclées, des mains de travailleur où d’autres aiguilles étaient plantées.
« Le Paris du pauvre », expliquai-je, prenant délicatement ses paumes dans les miennes, comme si je m’emparais d’un grand papillon de nuit.
« Ah », répondit papa, un peu plus détendu.
Il aimait Paris au printemps ; il aimait Paris, toute la chanson. L’année où il avait quitté le lycée, il lui était arrivé quelque chose dans cette ville ; l’amour, peut-être, ou l’avant-goût de la liberté après le chou bouilli, la mélancolie noyée dans le gin de son enfance en Grande-Bretagne. Après cela, chaque fois qu’il disposait d’une somme d’argent imprévue, ce qui n’arrivait pas souvent, il menaçait de prendre deux billets pour Paris.
« Ces Grenouilles savent y faire. On commence par le champagne, on finit à l’absinthe ; tu viens dîner avec ton chien, et si tu repars au bras de la serveuse, tout le monde s’en fout », disait-il.
Papa a emmené ma mère à Paris à trois reprises ; et moi, une fois. Il a essayé de convaincre ma sœur d’y aller pour ses quarante ans, mais Vanessa venait d’accoucher de son sixième enfant, elle se remettait à grand-peine dans une clinique bruyante de Lusaka, et n’avait pas envie de suivre mon père en haut de la tour Eiffel ou de déguster les premières mûres de la saison avec une bouteille de vin dans l’île de la Cité.
« Si j’arrive avec deux billets pour Paris, vous voudrez bien m’accompagner ? » demandait toujours papa à l’infirmière écossaise, aux yeux bleu cobalt, qui était notre voisine en Afrique australe, à l’époque où mes parents s’essayaient à l’agriculture dans une zone de conflit. Vanessa et moi l’appelions tante Rena ; en temps de guerre, le traumatisme fait lien, on se sent apparenté à tout le monde.
« Bien sûr, Tim », répondait toujours tante Rena.
Papa détestait les hôpitaux. « On t’empêche de fumer, pas moyen de boire un coup quand tu en as vraiment besoin, et on veut toujours te piquer à des endroits qui ne sont pas faits pour ça. » Il détestait aussi les médecins, à cause de leur tendance à attirer les mourants ou les blessés. « Ensuite, ils finissent le boulot. »
Il n’avait été hospitalisé qu’une fois auparavant, dans les années 1970, lorsqu’il s’était roulé dessus en réparant les freins d’une voiture, pendant notre période de travaux-agricoles-dans-une-zone-de-conflit. L’atelier, construit par l’ancien propriétaire de la ferme, un alcoolique atteint de mélancolie, n’était pas de niveau. « En cas d’inondation, disait papa, voyant le bon côté de la pente du sol en terre battue, l’eau devrait s’écouler facilement. »
Mais ça se passait dans la Rhodésie de l’époque révolutionnaire – imprévisible, bouleversée, éclatante –, notre ferme se trouvait dans une région sans pluie, même s’il y avait des inondations ; les épisodes de sécheresse étaient fréquents, et le lourd break anti-mines avait lentement roulé sur papa, sous les yeux horrifiés des employés impuissants de l’atelier.
« Pauvre papa, avait dit maman. Écrasé comme un cafard, et pourtant il soutenait mordicus qu’un cachet d’aspirine et deux cognacs suffiraient à le guérir. »
Tout le monde fut pris de panique ; une réaction peu commune en Rhodésie, qui allait à l’encontre de notre soi-disant caractère national. Nous étions le peuple le plus viril. « Ton père a été le premier habitant de la vallée à être héliporté en ville, déclara maman en reniflant avec nostalgie. Jusque-là, les gens étaient forcés de serrer les dents ; et dans les cas les plus graves, on nous transportait à l’hôpital à bord d’un Land Rover anti-mines bringuebalant. Pas d’amortisseurs, tu penses bien. »
Elle semblait me dépeindre la version sépia d’une vie qu’elle avait bien connue et qui incluait mon père, mais dont l’essence m’échappait, comme si je n’en avais jamais perçu moi-même l’acuité sanglante bien réelle.
« La souffrance insoutenable de la victime, conclut maman.
— Je m’en souviens, dis-je.
— Mais pour ton père, ça s’est passé autrement, continua-t-elle. Paul Dickenson, Dieu merci, a conduit papa dans sa Mercedes-Benz – elle marqua une pause, afin de me laisser le temps d’apprécier pleinement ce qu’elle venait de dire – jusqu’à la piste d’atterrissage de Brian Van Buren, qui l’a transporté aussitôt à l’aérodrome d’Umtali, de l’autre côté des lignes ennemies. »
Je me rendis compte que les choses devenaient un peu floues dans le récit de maman, où Out of Africa se superposait à l’un de ces films flamboyants de la Seconde Guerre mondiale qu’elle aime tant. Mais dans notre vraie vie, dans notre petite guerre du bush rhodésienne, il n’y avait pas vraiment de lignes ennemies, ni d’accents allemands de service ; Dieu nous impose la retenue. Mais à la guerre, il faut l’oublier. Il ne restait que le pays ; je veux dire la terre, et le sang.
Et les trois factions en conflit : les colons blancs, largement éparpillés ici et là, un peu partout ; les Mashona, regroupés à l’intérieur des kraals, dans les deux tiers du Nord du pays, les Matabele au Sud.
Jusqu’à la mort, juraient les colons. Naturellement, les Mashona et les Matabele n’avaient d’autre choix que de formuler le même vœu. Même un petit enfant aurait pu prévoir que la guerre serait une sale affaire qui durerait longtemps.
Les rebelles noirs avaient le soutien officiel de la Corée du Nord, de la Chine et de Bono ; ils étaient plus résistants qu’il n’est possible de l’imaginer, endurants et patients. Ils étaient là depuis toujours, et le temps d’une génération. Certains de ces musoja 1 avaient dû être des poètes, des danseurs, des fermiers ; mener une guerre avait sans doute été plus difficile pour eux. Mais les ancêtres les accompagnaient.
Les Rhodésiens blancs avaient le soutien des États-Unis, d’Israël, de l’Afrique du Sud et du Royaume-Uni ; ils étaient bien entraînés, et sans pitié. Leur armée se composait en grande partie de locaux noirs gérés par des conscrits blancs. Un pays entier de soldats, mais certains de ces appelés étaient sans doute aussi des poètes, des danseurs, des moines ; il avait sans doute été plus difficile pour eux de commettre des actes cruels. Ils abandonnaient les ancêtres qui les avaient abandonnés.
Papa fut affecté à une unité locale sur le front oriental, qui n’était pas difficile à trouver puisque nous y vivions déjà, mais à partir de ce moment-là notre vie devint plus compliquée. Il combattait six mois par an avec une poignée d’autres hommes blancs, des fermiers des environs, des frères d’armes. Ils étaient censés intercepter les rebelles venus du Mozambique qui entraient en Rhodésie. Papa n’en parlait pas beaucoup, sauf dans son sommeil.
Maman n’eut pas besoin qu’on le lui demande : elle proposa ses services. Elle s’engagea corps et âme comme si nous étions là depuis sept générations, et que notre vie même était en jeu. Elle porta vaillamment l’uniforme, une horrible robe droite en épais polyester qui aurait été mieux adaptée aux Alpes bavaroises qu’aux vallées étouffantes de la Rhodésie orientale.
« Bien sûr, nous ne pensions pas que la guerre continuerait aussi longtemps, ni que nous la perdrions », dit maman après. Elle me fusilla du regard. « Nous avons eu un choc quand Robert Mugabe est arrivé ; je savais exactement ce que ça signifiait. Ou peut-être que tu ne t’en souviens pas. »
Si, je me souviens.
Je me rappelais aussi ce qui s’était passé ensuite, même s’il ne s’agit pas que d’une seule histoire, mais de milliers d’histoires, peut-être de millions. Et ce n’est pas juste la nôtre, ou bien nous en faisons partie, mais elle n’est pas arrivée qu’à nous ; d’autres gens l’ont vécue, et nous l’avons subie avec une force égale. Ou plutôt inégale, devrais-je dire. Il faudrait attendre des générations pour que les ondes de choc quittent le pays.
Ou bien les générations sont déjà passées ; nous sommes encore là.
« Alors, bien sûr, on a tenu le coup », conclut maman.
Notre nation était sans aucun doute en guerre contre elle-même ; les cadavres s’empilaient. Nous avions tous des parents sur le front, sauf s’ils avaient déjà été « enlevés », effacés, battus. Mais le professeur d’écriture sainte de notre école primaire nous assura que les Noirs n’avaient que ce qu’ils méritaient : « Dieu punit l’iniquité des pères sur les fils jusqu’à la troisième et la quatrième génération. »
Il y avait des camps militaires et des champs de mines. Des banlieues derrière les barbelés, des chiens patrouillant les pelouses tondues. Des convois, des couvre-feux, des sanctions, et la censure. Le pays tout entier avait été transformé en un vaste champ de bataille chaotique, et il n’existait aucun moyen d’en sortir.
« Oh, Bobo, dit maman. Tu exagères. »
Au contraire de moi, elle préfère ne pas se souvenir de la guerre, ni d’un détail de nos vies. Tous ses récits sont empreints du cliquetis des films en celluloïd et du velours râpé des confortables fauteuils d’un cinéma à l’ancienne. Par conséquent, ses histoires sont meilleures que les miennes, débordant d’une imagination plus vivace, moins déprimantes.
« Et, poursuivit maman avec animation, papa a été transporté directement de l’aérodrome au centre hospitalier d’Umtali à bord d’une ambulance. Tu imagines ! Il hurlait sans arrêt. Il voulait qu’on l’emmène au Wise Owl, à l’Impala Arms, au Cecil Hotel, n’importe où, mais pas à l’hôpital. Après, les brancardiers ont tenu absolument à tout me raconter. » Elle s’interrompit. « Bien sûr, ça n’aurait rien changé. Le chauffeur n’entendait pas les supplications désespérées de papa à cause du hululement de la sirène. Ah, c’était le bon temps, Bobo. Il se passait toujours quelque chose d’excitant. »
Comme l’amour, la guerre est une affaire sanglante quand elle survient, et un vrai gâchis une fois terminée ; mais avec un certain recul, on peut considérer l’un ou l’autre, et ne voir que la gloire, ou seulement la douleur. La vérité obscure – qui réside quelque part dans la confusion humaine – est très difficile à saisir. En fait, on la décèle à peine à travers l’étain terni du crépuscule ; elle est floue, informe, ou simplement ailleurs.
En Dieu peut-être, ou dans le temps ; c’est la grâce, bien sûr. Certains soldats prétendent l’avoir vue dans la fumée de la poudre ; les femmes, à l’instant de la mise au monde d’un enfant, l’entrevoient brièvement ; cette vérité existe au commencement de toute chose, et dans la fin de chaque être. Mais discerner cette clarté dans la routine quotidienne, et non dans les moments ultimes, ou in extremis : c’est une grâce incroyable, et peu commune.
Il y a toujours une effroyable période d’attente, un purgatoire du doute, entre la souffrance et la grâce. C’est un cheminement ardu et solitaire, un parcours qui demande de l’endurance et vous contraint à vous déconstruire pierre à pierre, à vous dépouiller du superflu, à raboter les aspérités. Une grâce incroyable vous apparaît lorsque la foi s’est envolée ; quand l’épuisement ultime vous gagne ; si aucune piste ne s’offre à vous et que vous poursuivez votre route sans vous décourager.
« Voyager léger, disait mon père. Aller vite. »
Il suivait ce conseil, pratiquait ce qu’il prêchait, comme si c’était un principe clé de sa religion personnelle. « Du tabac, du thé et une moustiquaire. Lorsque tu souffres jusqu’à la moelle, tu n’as besoin de rien d’autre. »
Lorsque tu souffres jusqu’à la moelle.
Papa admirait beaucoup les hommes qui savaient souffrir ; il en faisait la remarque. Il ne tarissait pas d’éloges sur les paysans d’Afrique australe. « Pauvres bougres, cinq siècles d’entraînement », observait-il. D’après lui, les Britanniques étaient nuls, excepté la reine. « Elle encaisse sans broncher. » Les Italiens manquaient de dignité. « Ils appellent leur mère au secours. » Et avec les Américains, on ne pouvait pas savoir, « parce que ça fait un peu trop de bruit ».
L’annexe de l’unité des hommes de l’hôpital d’Umtali, où papa fut transporté après s’être roulé dessus, était un baraquement peu élevé, construit à la hâte pour accueillir l’afflux des victimes de guerre qui arrivaient du front oriental (reconnu officiellement). « À la porte de notre cuisine, pour ainsi dire, expliquait maman avec une humilité feinte. Nous étions là, Bobo, et eux, tout à côté. »
Les soldats blessés s’asseyaient au soleil, ou se promenaient d’un pas lent, du moins ceux qui le pouvaient, la bouche figée en un perpétuel « oh », comme si la stupéfaction véhémente causée par l’explosion qui les avait conduits dans ces murs n’avait pas fini de s’exprimer. « Ne reste pas bouche bée », me rappelait Vanessa.
La tristesse, le gâchis et l’iniquité de la guerre mettent des décennies à s’évacuer d’un lieu et de la mémoire d’un peuple. Jusqu’à la fin, mon père a crié et jeté des choses dans son sommeil. « Il n’y a plus de poignées sur les portes de penderies, se plaignait maman. Et je ne peux plus ouvrir ni fermer convenablement aucun tiroir. La névrose traumatique de ton père a transformé en cure-dents les meubles de notre chambre. »
Pourtant la guerre ne lui inspirait aucun sentiment d’amertume ; pas plus qu’à mon père, enfin pas vraiment. Pour eux, c’était comme ça ; leurs regrets étaient très différents des miens, moins douloureux sans doute, notre culpabilité n’avait rien en commun. « Je me sentais atrocement mal dans ce lit d’hôpital, dit papa. Non que mon adresse au tir ait empêché un seul Asiate de dormir. Mais tu n’as pas envie qu’un autre type prenne ton tour de batte juste parce que tu as été assez con pour te rouler dessus. »
Même alors, avec le genou droit aussi gonflé qu’une pastèque, l’épaule droite aplatie comme une crêpe, les côtes cassées, les organes meurtris, mon père pestait contre son hospitalisation. Pour alléger cette épreuve, ma mère lui apportait en douce des bouteilles de cognac maintenues contre son corps par des lanières et dissimulées sous un caftan. « Le caftan du milieu des années 1970. Pas très flatteur, mais très pratique », dit-elle.
Peu après, papa organisa à l’improviste une journée sportive pour les amputés atteints de névrose traumatique : des courses à trois jambes, des zigzags en fauteuil roulant, une partie de cricket manchot. L’hilarité fut générale, mais il y eut aussi de nouveaux accidents et d’autres blessures. La course en sac fut un désastre absolu pour les taies d’oreiller de l’hôpital.
« Il a été le pire patient de l’histoire du centre hospitalier d’Umtali », déclara maman, avec une bonne dose de fausse vanité, comme lorsqu’elle se réjouit modestement de voir l’un de ses chiens mordre quelqu’un. « Et la concurrence était assez rude, crois-moi. À la fin, ils ont été forcés de le laisser partir plus tôt. »