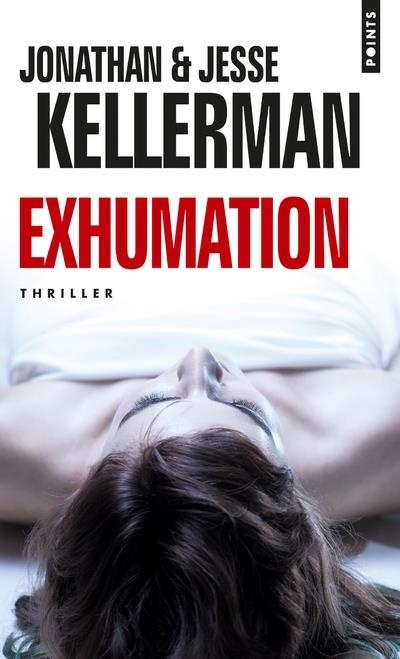Exhumation
Les morts, Clay Edison les côtoie plus que les vivants. Son travail, c'est de classifier : homicide, suicide, cause naturelle, accidentelle ou indéterminée. Alors que le jeune coroner étudie le décès d'un professeur de Berkeley, la fille du défunt est persuadée qu'il s'agit d'un assassinat.
Son enquête mène Clay vers une autre disparition, plus ancienne et sordide...
Tout le talent de Jonathan Kellerman (La Psy) et de Jesse Kellerman (Les Visages), réunis dans ce nouveau thriller, premier opus d'une nouvelle série.
Extrait
Ne jamais rien présupposer.
Régulièrement, je me remémore cette règle. Régulièrement, l’univers se charge de me la remémorer.
Quand je rencontre des gens nouveaux, en général
ils sont morts.
Trois heures du matin. Un individu de sexe masculin, blanc, jeune, gît sur le dos sur le parking d’un bâtiment du campus de Berkeley. D’après le permis de conduire dans son portefeuille, il s’appelle Seth Lindley Powell. Il a dix-huit ans depuis quatre mois. Le permis indique une adresse à San Jose. Il y a fort à parier que ses parents se trouvent actuellement à cette adresse, endormis dans leur lit. Personne ne les a encore prévenus. Je n’en ai pas eu le temps.
Seth Powell a des yeux gris limpides, les cheveux châtain clair et les paumes ouvertes, tournées vers le ciel nocturne. Il porte un polo marron informe et un pantalon de treillis. Un de ses lacets est défait. À part quelques égratignures superficielles sur la joue gauche, il a le visage lisse et la mine joyeuse, quoique bleuâtre. Son crâne, sa cage thoracique, son cou, ses bras et ses jambes sont intacts. Il n’y a presque pas de sang.
Au bout du parking, derrière le ruban jaune de la police, se masse une foule d’étudiants qui prennent des photos de Seth. Et des selfies. Certains s’enlacent et pleurent, d’autres se contentent de regarder, curieux.
Les trottoirs sont jonchés de gobelets en plastique rouges. Une banderole accrochée à la façade annonce le thème de la soirée : SATURDAY NIGHT FEVER. Des garçons livrent leur témoignage d’une voix pâteuse à des agents en uniforme. Des filles en talons compensés tripotent les boutons de chemisiers criards en polyester, dénichés dans les bacs à cinq dollars des solderies de Telegraph Avenue. Personne ne sait ce qui s’est passé, mais tout le monde y va de sa version. D’une fenêtre au deuxième étage proviennent les éclats de lumière paresseux d’une boule à facettes que nul n’a pensé à arrêter.
Penché sur le corps de Seth Powell, je me laisse aller à une supposition : je me demande comment je vais pouvoir expliquer à ses parents que leur fils est mort d’une intoxication alcoolique pendant sa première semaine de fac.
Et je me trompe.
Le lendemain après-midi, un technicien entre dans le bureau de la brigade, m’arrache à mon ordinateur et me demande de l’accompagner à la morgue afin que je puisse voir de mes propres yeux la bouillie d’organes à l’intérieur de la cavité abdominale, les vertèbres inférieures déboîtées de leur alignement, le bassin en miettes, le tout étant cohérent avec une chute de quatre étages et un impact sur le coccyx.
Ce n’est pas pour rien qu’on fait des autopsies.
Les analyses toxicologiques confirment ce que les amis de Seth ont tous répété avec insistance, et que j’hésitais à croire : il ne buvait pas. C’était « le mec bien », le mec pur et intègre. Il écrivait des chansons. Il prenait des photos artistiques en noir et blanc avec un appareil argentique. La semaine de bizutage le déprimait. Quelqu’un a entendu dire qu’il était monté sur le toit pour observer les étoiles.
Le déprimait à quel point ?
À un moment, vous devez prendre une décision. Vous devez cocher des cases. Le fait qu’il existe un nombre infini de manières de mourir mais seulement cinq catégories de mort en dit long sur notre désir de simplicité.
Homicide.
Suicide.
Naturelle.
Accidentelle.
Indéterminée.
Mon boulot commence avec les morts mais continue
avec les vivants. Les vivants ont des téléphones avec des touches bis. Ils ont des regrets, des insomnies, des douleurs thoraciques, des crises de larmes incontrôlables. Ils demandent : Pourquoi ?
Quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, pourquoi n’est pas une vraie question. C’est une expression de désespoir. Même si je connaissais la réponse, je ne suis pas sûr que quiconque pourrait l’encaisser.
Alors je fais de mon mieux. La bonne vieille ruse. Ils me demandent pourquoi, je leur réponds comment. Sachant qu’il est impossible de vivre sans présupposés,
j’essaye de choisir les miens avec soin. Je songe au lacet défait. Je classe la mort de Seth Powell dans les accidents.
Cinq ans plus tard, je pense encore à lui chaque fois que je reçois un appel de Berkeley.
On ne m’appelle pas souvent de Berkeley. Le comté d’Alameda couvre deux mille kilomètres carrés, au milieu desquels le campus de Berkeley constitue un grain de poussière, grosso modo épargné par la grande criminalité, comparé à son voisinage, sauf si vous considérez comme criminels les SDF et les réinterprétations vegan chichiteuses de plats traditionnels, ce qui n’est pas mon cas. Pourquoi rechigner devant un bon burger au tofu ?
Cinq ans après la mort de Seth Powell, quasi jour pour jour, à 11 h 52 un samedi matin de septembre, Zaragoza était penché par-dessus la cloison de mon box et se palpait la chair sous l’extrémité gauche de sa mâchoire, en quête du dernier développement qui allait sans nul doute laisser sa femme veuve et ses enfants orphelins.
« Hé, Clay, touche-moi ça.
– Toucher quoi ? répondis-je, sans lever les yeux de mon travail.
– Mon cou.
– Je ne te toucherai pas le cou.
– On le sent quand on appuie fort.
– Je te crois.
– Allez, mec, j’ai besoin d’un deuxième avis. – Mon avis, c’est que la semaine dernière, tu m’as
demandé de te toucher le ventre.
– J’ai regardé sur Internet, c’est un cancer du pha-
rynx. Ou peut-être des glandes salivaires, mais ça, c’est plutôt rare.
– Toi aussi, tu es plutôt rare », rétorquai-je.
Ma ligne fixe sonnait. Je mis le haut-parleur. « Bureau du coroner, ici Edison.
– Bonjour, ici l’inspecteur Schickman, de Berkeley.
Comment ça va ? »
Voix sympathique.
« Qu’est-ce qui se passe ? répondis-je.
– J’ai un cadavre sur les bras. C’est sûrement une mort
naturelle mais, vu qu’il est au pied d’un escalier, je me suis dit que vous voudriez peut-être venir jeter un œil.
– Sans problème. Attendez une seconde, je ne trouve plus mes petits formulaires. »
Zaragoza me tendit machinalement un formulaire vierge tout en continuant à se tâter le cou.
« Je vais aller faire une IRM, déclara-t-il. – Pardon ? demanda Schickman dans le haut-parleur. – C’est rien, dis-je en décrochant le combiné. C’est
mon collègue qui a un cancer.
– Merde, lâcha Schickman. Désolé de l’apprendre. – Il va s’en tirer, il en a un différent chaque semaine.
Allez-y, je vous écoute. Nom de famille du défunt ? – Rennert.
– Ça s’écrit ? »
Il me l’épela, avant de poursuivre :
« Prénom, Walter. Ça s’écrit comme vous pensez. »
Je posais des questions, il répondait, je notais. Walter Rennert était un homme blanc divorcé de soixante-quinze ans, résidant au 2640 Bonaventure Avenue. Vers 9 h 40, sa fille était arrivée chez lui pour leur traditionnel brunch hebdomadaire. Elle avait ouvert avec sa clé et avait trouvé son père étendu par terre dans le hall d’entrée, inconscient. Après avoir appelé les secours, elle avait essayé en vain de le réanimer. Les pompiers de Berkeley l’avaient déclaré mort à 10 h 17.
« C’est sa plus proche parente ?
– Je crois. Tatiana Rennert-Delavigne. »
Il me l’épela sans que je le lui demande.
« Est-ce qu’il y a un médecin traitant ?
– Euh... Clark. Gerald Clark. Je n’ai pas réussi à le
joindre. Son cabinet est fermé jusqu’à lundi.
– On sait quelque chose de son état de santé ? – Hypertension, d’après la fille. Il prenait des médocs. – Et vous dites qu’il est au pied de l’escalier ? – Quasi. Du moins, il est allongé là.
– Ce qui signifie ?
– Ce qui signifie que c’est son emplacement. Mais je n’ai pas l’impression qu’il ait glissé.
– Hmm hmm. OK, on va venir voir ça.
– D’accord. Écoutez, je ne suis même pas sûr que je devrais vous en parler, mais sa fille est persuadée qu’il a été assassiné.
– Elle vous a dit ça ?
– C’est ce qu’elle a dit quand elle a appelé les secours : “Venez vite, mon père a été assassiné.” Quelque chose comme ça. Et elle a répété la même chose aux premiers flics arrivés sur place. C’est eux qui m’ont prévenu. »
Jusque-là, j’aimais bien ce Schickman. Il m’avait l’air de savoir ce qu’il faisait. Aussi attribuai-je l’hésitation dans sa voix à une incertitude sur la façon de se conduire avec la fille du défunt plutôt qu’à la moindre inquiétude sur le fait qu’elle puisse avoir raison.
« Vous savez comment c’est, reprit-il. Les gens sont sous le choc, ils disent toutes sortes de choses.
– Ouais. Je peux noter votre numéro matricule, vite fait ? – Schickman. S-C-H-I-C-K-M-A-N. Soixante-deux. » Berkeley. Même si je conçois que ça ne plaise pas
à tout le monde, il faut reconnaître qu’il y a un certain charme désuet à un département de police suffisamment petit pour avoir des matricules à deux chiffres.
Je lui dictai mes coordonnées en lui disant qu’on arrivait.
« À tout de suite. »
Je raccrochai, me levai, m’étirai. Dans le box d’à côté, Zaragoza avait ouvert Google Images et faisait défiler un épouvantable catalogue de tumeurs.
« Tu t’amènes ? » lançai-je.
Il haussa les épaules et referma la fenêtre de son navigateur.